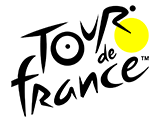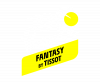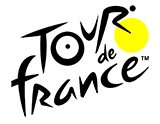PAU
Le Tour des Géants
La cité d’Henri IV est aussi depuis plusieurs étés la ville du Tour des Géants, des statues à la gloire des vainqueurs de la Grande Boucle. Sur chacun de ces totems figurent le nom et la photo du vainqueur de l’année concernée ainsi qu’un texte rédigé par l’écrivain Christian Laborde. Les totems de près de deux mètres de haut forment un monument permanent disposé dans un écrin de verdure au Bois Louis, à proximité du Stade Philippe Tissié. Le site, aménagé sous forme de spirale, accueille une nouvelle sculpture tous les ans. Chaque effigie d’aluminium et de verre (trois d’entre elles sont en bronze) affiche le nom et la photo du vainqueur de l’année, le nombre de kilomètres parcourus, sa moyenne et des photos ou des dessins, accompagnés d’un texte dynamique et original. À noter qu’un QR Code est apposé sur chacun des édifices. En scannant le code avec un smartphone, il est possible d’écouter ce texte traduit en plusieurs langues.
Le Boulevard des Pyrénées
Achevé en 1900, il donne à voir un panorama exceptionnel sur près de 150 km de la chaîne des Pyrénées. Sa balustrade de 850 mètres de long sert de rambarde d'orientation. C’est à Jean-Charles Alphand que l’on doit l’esprit du projet de Boulevard des Pyrénées quand il écrivait : « Il manque à Pau la promenade des Anglais de Nice ». Le boulevard est donc conçu comme une réplique montagnarde de l’artère niçoise, lieu privilégié pour « voir et se faire voir ». Cette promenade au bord d’un abrupt en balcon totalement artificiel représente une prouesse technique et esthétique, qui structure et organise depuis sa création le développement urbain.
Le Parc et le Palais Beaumont
Construction : 1900
Style : néo-classique.
Architecte : Émile Bertrand.
Caractéristiques : construit pour accueillir la riche clientèle en villégiature, le Palais d’hiver dit Palais Beaumont abrite aujourd’hui un casino et un centre de congrès. Le site est situé au cœur d'un parc composé d’arbres remarquables et d’un théâtre de verdure. Le village départ du Tour y a souvent été installé.
Le musée national château de Pau
Construction : XIIe au XIXe siècles.
Style : médiéval et composite.
Histoire : posées sur un éperon rocheux qui domine un gué du Gave, les fondations du château de Pau remontent au haut Moyen Âge. Henri IV y vit le jour le 13 décembre 1553. Restauré sous Louis-Philippe, le château devint un musée en 1926. Outre ses appartements royaux, il abrite d’importantes collections consacrées à Henri IV ainsi qu’un grand nombre de tapisseries et son berceau carapace y figure toujours en bonne place.
Caractéristiques : construit sur un éperon rocheux, il présente un plan polygonal très irrégulier, au sommet de deux talus entourés par la première puis la deuxième enceinte. À l'intérieur de cette deuxième enceinte, le château est bâti sur le même plan polygonal. Il est aujourd'hui flanqué de six tours, tandis qu'une septième, dite de la Monnaie, fait partie de la première enceinte. Ces tours sont toutes rectangulaires et reliées par un gros mur contre lequel s'appuient les bâtiments d'habitation formant le logis.
Destination actuelle : résidence de prestige pendant des siècles, le château est devenu en 1926 un musée national dédié à Henri IV.
Classement : classé Monument Historique en 1840.
http://www.musee-chateau-pau.fr/
Les rives du Gave
Ce sont 250 hectares traversés par les 13 km de berges du Gave. Remarquable par son patrimoine naturel, ce parc a pour ambition de permettre à chacun de profiter d’un espace naturel en ville. Différents aménagements sont mis à la disposition des promeneurs tels que des bancs, tables de pique-nique, etc. Sur les rives du Gave on trouve aussi le stade d’eaux vives et la voie bleue pour faire une pause sportive et aquatique : balade en canoë ou parcours en rafting.
Le domaine de Sers
Le domaine de Sers, 25 hectares de verdure, nouvellement inauguré, fait la part belle aux habitants. Il héberge outre les serres municipales, la Maison du jardinier, un lieu d'information, de conseil et d’animation autour du jardinage durable. C’est aussi une démarche d’accompagnement des citoyens dans les projets de végétalisation de l’espace public.
GAVARNIE-GÈDRE
Cirque de Gavarnie
Le cirque de Gavarnie est un cirque naturel de type glaciaire. Il fait partie du parc national des Pyrénées et a été inscrit en 1997 au patrimoine mondial de l’UNESCO dans l’ensemble Pyrénées-Mont Perdu. Les terrains calcaires gris, ocre ou rosés, y ont été retournés et soulevés jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. La zone géologique du cirque de Gavarnie est un exemple géologique de nappe de charriage. Tout au long, les glaciers quaternaires ont « surcreusé » les bassins de Pragnères, de Gèdre et de Gavarnie ; les eaux ont scié les « verrous » rocheux qui les séparent et créé des « étroits » dont le plus caractéristique est la gorge de Saint-Sauveur.
Au milieu du cirque, légèrement sur son versant oriental, se tient la cascade de Gavarnie, haute de 422 mètres, à la source du gave de Gavarnie donnant le gave de Pau. Sous la ligne de crêtes, dans la partie haute du cirque, se trouvent plusieurs glaciers reliques : glacier de la Brèche, glacier du Casque, glacier de l'Épaule, glacier de la Cascade, glacier ouest du Marboré.
Le cirque est accessible par le fond de vallée à partir du village de Gavarnie ou par le haut en empruntant l’échelle des Sarradets. Considéré comme une merveille naturelle, il est l’un des sites les plus visités des Pyrénées.
Festival de Gavarnie
Création : 1985 (plus organisé depuis 2023)
Histoire : le Festival de Gavarnie est un festival de théâtre organisé sur le site classé du cirque de Gavarnie. Une pièce classique ou contemporaine y est donnée au milieu de l’été, pour plusieurs représentations. Le festival est créé en 1985 par François Joxe. Avec sa compagnie parisienne du Chantier-Théâtre, il propose un spectacle spécialement conçu pour les lieux dans chacune des vingt premières éditions du festival, en conciliant création artistique et nature dans un site classé. Après une pause en 2005, le festival reprend en 2006 avec le spectacle de la compagnie « Il est une fois ». Depuis 2007, l’association Théâtre Fébus anime le festival sous la direction de Bruno Spiesser. Ce dernier est remplacé en 2019 par Frédéric Garcès. En 2023, les conditions météo empêchent la tenue du festival, qui n’a pas repris depuis pour des raisons financières. Son avenir reste en suspens.
Signe particulier : le Festival de Gavarnie se déroulait au pied du cirque de Gavarnie en plein air à une demi-heure de marche environ du village de Gavarnie, sur la plaine de la Courade à 1 450 m d'altitude, ce qui en faisait le plus haut festival d’Europe.
Église Notre-Dame du Bon-Port
Construction : XIIe au XIXe siècle.
Style : roman.
Histoire : L’église doit son origine aux moines de Saint-Jean de Jérusalem, dont l’hospice est mentionné dès 1257. Sa chapelle est agrandie au XIVe siècle et prend alors le vocable de Notre-Dame du Bon Port. D’importants travaux s’étalent sur toute la durée du XIXe siècle. En 1820, alors que des vestiges de l’ancien hôpital sont encore visibles, l’église s’effondre, entrainant le clocher. En 1851, il est décidé de reconstruire et d’aménager une chapelle supplémentaire. Les travaux s’éternisent jusqu’en 1878. En 1910, des vitraux de Louis-Victor Gesta sont installés.
Caractéristiques : l’église actuelle, dotée d'une voûte en berceau brisé et d’une tribune avec galeries latérales date essentiellement du début du XIXe siècle. Elle présente cependant quelques vestiges du XIVe siècle : sa chapelle nord remonte à l’époque romane et à l’extérieur du bâtiment, on distingue encore la base ancienne d’une tour carrée qui supportait l’ancien clocher-mur.
Classement : située sur l’un des itinéraires menant à Saint-Jacques de Compostelle, l’église est classée à ce titre au Patrimoine Mondial depuis 1998.
Cimetière de Gavarnie (cimetière des Pyrénéistes)
Caractéristiques : le cimetière est particulièrement remarquable pour son « carré des pyrénéistes », une partie du cimetière où sont inhumés d'illustres pyrénéistes, guides, montagnards professionnels ou amateurs, qui ont payé de leur vie leur passion de la montagne. L’initiative de ce carré date de la fin des années 1920.
Reposent dans le cimetière les pyrénéistes Henri et Célestin Passet, François Bernat-Salles (1855-1934), Georges Ledormeur, (1867-1952), Ludovic Gaurier, (1875-1931), Jean Arlaud, (1896-1938), Georges Adagas, (1920-1987), Raymond d'Espouy, (1892-1955), Jean Prunet et Diego Calvet, (1898-1922).
Classement : Monument historique depuis 1998.
Statue du comte Henry Russell
Construction : 1952 (copie d’un bronze de Gaston Leroux de 1911).
Histoire et caractéristiques : la statue est implantée sur la route d’arrivée à Gavarnie, quelques mètres avant le Pont de Cumia. Après une souscription du Club Alpin Français qui décide d’élever un monument à la mémoire du Comte, le choix se porte sur l’œuvre de Gaston Leroux, sculpteur bordelais. La statue, réalisée en 1910, est inaugurée à Gavarnie le 5 septembre 1911. L’œuvre, en bronze, est fondue par les Allemands pendant la guerre. Le 20 juillet 1952 a lieu l’inauguration, à l’initiative du Musée Pyrénéen, de la nouvelle statue de Russell, réalisée d’après l’original.
Signe particulier : explorateur et pionnier du pyrénéisme, le comte franco-britannique Henry Russell (Toulouse 1834-Biarritz 1909) a réalisé une trentaine de « premières ascensions » dans les Pyrénées entre 1858 et 1885. Personnage excentrique, rêveur et contemplatif, il incarne un pyrénéisme romantique et se montre critique à l'égard du pyrénéisme sportif qui tend à sa développer à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de jeunes montagnards et du Club alpin français. Il a donné son nom au pic Russell (3 206 m) dans les Pyrénées espagnoles.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France