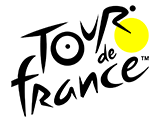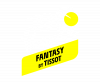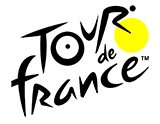CARCASSONNE
La Cité médiévaleConstruction : ancien oppidum gaulois (v. 300 avant J.C.), cathédrale et château comtal au XIe et XIIe siècles.
Style : médiéval, néo-médiéval (restauration Viollet-le-Duc au XIXe siècle)
Superficie : 1 361 ha
Caractéristiques : située sur la rive droite de l’Aude, la Cité médiévale est une ville fortifiée unique en Europe par sa taille et son état de conservation avec ses 52 tours et ses deux enceintes concentriques qui totalisent trois kilomètres de remparts. Son histoire est marquée par 2 000 ans de conquête et par l’empreinte du catharisme et des Croisades.
Histoire : centre du pouvoir des comtes de Carcassonne puis de la célèbre famille Trencavel au XIIe siècle, elle devient, après la croisade des Albigeois (1209-1229) où les forces royales s’emparent de Carcassonne, accusée de complicité avec les Cathares, une place forte royale gouvernée par un sénéchal. Elle garantit la frontière entre la France et l’Aragon jusqu’au traité des Pyrénées en 1659. Au XIXe siècle, la ville est au bord de la démolition et sert de carrière de pierres. Pendant plus de 50 ans (de 1853 à 1911), Viollet-le-Duc et son successeur Paul Boeswillwald lui redonnent son aspect médiéval : destruction des constructions parasites entre les deux enceintes, couverture en lauze grise des tours et restauration des décors, des hourds sont entreprises. Dans les années 60, les tours gallo-romaines sont coiffées de tuiles.
Classement : Patrimoine mondial de l’Unesco.
Construction : XIIe, XIIIe et XIXe siècles
Histoire et caractéristiques : le château des vicomtes Trencavel se niche dans l’enceinte de l’ancienne Cité, adossé à la courtine intérieure ouest à l’endroit où la pente est la plus raide. Il possède un plan en forme de parallélogramme allongé du nord au sud et percé de deux issues à l’ouest du côté de la porte de l’Aude et à l’est du côté intérieur de la Cité. Sa construction est lancée par Bernard Aton IV Trencavel aux alentours de 1130 pour remplacer un château primitif probablement situé à l’emplacement de la porte Narbonnaise. Le château est constitué de deux corps de bâtiment en « L » dominés par une tour de guet, la tour Pinte. Au nord se trouve une chapelle dédiée à la Vierge Marie dont il ne reste aujourd’hui que l’abside. Seule une palissade séparait le château du reste de la Cité. Tombé dans le domaine royal, le château, entre 1228 et 1239, devient une forteresse à l’intérieur de la Cité. Une barbacane comportant un chemin de ronde et un parapet crénelé barre l’entrée du château juste avant le fossé qui l’entoure complètement. La porte d’entrée du château est encadrée par deux tours. Le château et son enceinte comportent neuf tours dont deux sont d’époque wisigothe : la tour de la chapelle et la tour Pinte. La tour Pinte est une tour de guet carrée, la plus haute de la Cité. Toutes les autres tours ont des dispositions identiques, car construites en même temps aux XIIe siècle. L’accès du château mène à une cour d’honneur entourée de bâtiments remaniés de nombreuses fois entre les XIIe et XVIIIe siècles.
Classement : Monument historique depuis 1840.
Construction : XIe siècle, XIVe siècle, XIXe siècle.
Style : roman et gothique.
Histoire et caractéristiques : c’est d'abord une simple église consacrée cathédrale par le pape Urbain II en 1096. Sur son emplacement se trouvait une cathédrale carolingienne dont il ne reste aucune trace. La crypte date aussi de l’époque de la construction de la nouvelle cathédrale par la famille Trencavel. Les vitraux originaux de la basilique se trouvent dans la Sainte-Chapelle à Paris. La cathédrale est construite en grès. Elle est agrandie entre 1269 et 1330 dans le style gothique imposé par les Français, avec un transept et un chœur très élancés, un décor de sculptures et un ensemble de vitraux qui comptent parmi les plus beaux du sud de la France. Les rénovations d’Eugène Viollet-le-Duc ont largement transformé son extérieur, mais l’intérieur est le plus remarquable. On observe alors les deux styles, gothique et roman, sur les vitraux, les sculptures et tous les décors de l’église. En 1801, l'église est déchue de son rang de cathédrale au profit de l'église Saint-Michel, située dans la bastide à l'extérieur de la Cité. Elle devient basilique en 1898, à l’initiative du pape Léon XIII.
Classement : Monument historique depuis 1840.
Construction : 1908
Caractéristiques : le théâtre, qui se situe à l'intérieur de la cité médiévale, a été créé sur l’emplacement de l’ancien cloître Saint-Nazaire. Il comptait près de 6 000 places (un peu plus de 3 000 autorisées aujourd’hui) et le public était installé sur des bancs ou de simples chaises.
Signe particulier : En 1957, Jean Deschamps, acteur et metteur en scène, crée le célèbre Festival de la Cité, qui se déroule, depuis lors, chaque été. Le théâtre fut modifié en 1972. En hommage à l'action de Jean Deschamps, le Grand Théâtre de la Cité a pris le nom de « théâtre Jean Deschamps » le 15 juillet 2006.
Construction : XIVe siècle.
Histoire et caractéristiques : le pont relie la Ville Haute (cité) et la Ville Basse. Au Moyen Âge, il était l’unique passage pour accéder à la Cité. Le plus ancien document qui le concerne remonte à 1184. Il fut probablement réparé au XIVe siècle. Il se compose de douze arches plein cintre d’inégale longueur s’appuyant sur des piles munies d’avant et d’arrière-becs à éperons aigus. Des refuges sont établis sur les becs. Sur la troisième pile du côté de la Ville Basse s’élevait un mur ouvert d’une porte en plein cintre, séparant la Ville Basse de la Ville Haute.
Classement : Monument historique depuis 1926.
Histoire : la première église Saint-Michel fut détruite au début du XIIIe siècle. En 1283, le roi Philippe le Hardi autorisa le recteur à acquérir neuf maisons pour l’agrandissement de l’église. Elle fut reconstruite dans le troisième quart du XIIIe siècle. Après l’excursion du Prince Noir, le bourg fut protégé par une nouvelle enceinte qui s’appuyait contre le mur méridional de la nef. Entre 1417 et 1419, on construisit un large couvert au-dessus de la grande porte occidentale. En 1657, des voûtes d’ogives furent construites sur la nef. En 1803, l’église paroissiale devint cathédrale et des aménagements intérieurs transformèrent l’église à cette nouvelle fonction. Un incendie ravagea le chœur en 1849. En 1857, Viollet-le-Duc entreprit une vaste campagne de restauration, typique de son travail.
Caractéristiques : la large nef unique de huit travées était couverte à l’origine par une charpente apparente et bordée de chapelles latérales voûtées d’ogives prévues dans le plan d’origine. Le chevet tripartite est composé d’une abside centrale à sept pans et d’une travée droite bordée de deux absidioles voûtées d’ogives. Les chapiteaux de la nef sont simplement moulurés. La chapelle nord de la cinquième travée correspond au porche d’un ancien portail. Le clocher est établi au nord de la première travée de la nef et est desservi par une tourelle d’escaliers. La façade occidentale est ajourée par une grande rose et par un portail.
Classement : Monument historique depuis 1886.
Œuvre de Pierre Paul Riquet réalisée au XVIIe siècle pour relier l’Atlantique à la Méditerranée, le Canal du Midi, autrefois utilisé pour le transport de marchandises et de personnes, est aujourd’hui fréquenté par de nombreux plaisanciers et touristes. Depuis 1996, le Canal du Midi est classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Écluses, ponts, aqueducs, ponts-canaux qui parcourent les 240 kms de voie d’eau, témoignent à la fois d’une prouesse technique mais aussi d’une œuvre d’art.
Bastide Saint-LouisElle a été imaginée au XIIIe siècle sous l’impulsion du roi Saint Louis, qui créa une seconde cité médiévale. Bien qu’incendiée par le Prince Noir, la Bastide a gardé son plan orthogonal originel jusqu’à aujourd’hui. Sa prospérité de ville drapière au XVIIème siècle, puis le négoce du vin à partir du XIXème siècle, y ont permis d’édifier plusieurs hôtels particuliers à l’architecture remarquable. Environ 700 000 visiteurs viennent chaque année à pied depuis la Cité, empruntant le Pont Vieux, pour découvrir les commerces originaux de la Bastide, dans une ambiance de ville méridionale, jusqu’aux berges du Canal du Midi.
Les vignobles (patrimoine vivant)« Cité de Carcassonne » est une appellation IGP (Indication Géographique Protégée) couvrant 3 000 hectares répartis en 27 exploitations, dont 9 situées sur la commune de Carcassonne, jusque sous les remparts de la Cité. Le vignoble incite à l’escapade et à la découverte de larges espaces naturels aux paysages très changeants : la Malepère, les Corbières, le Minervois, la Montagne Noire, offrent des airs de Cévennes avec leurs châtaigneraies profondes, des ambiances toscanes depuis les collines aux bouquets de cyprès.
FOIXChâteau des Comtes de Foix
Construction : XIe siècle
Style : château fort
Caractéristiques : dressé sur un piton rocheux, ce château du Moyen Âge domine de ses hautes murailles et de ses trois tours la ville médiévale de Foix. Il offre une vue panoramique sur les Pyrénées.
Histoire : cette forteresse imprenable et toujours intacte fut construite dès l’an mille. Il fut la demeure des comtes de Foix dont certains furent célèbres, comme Gaston Phébus, auteur de la devise « touches-y si tu l’oses ». Henri III de Navarre, dernier comte de Foix, devint roi de France sous le nom d’Henri IV.
Destination actuelle : musée départemental de l’Ariège, le château consacre plusieurs salles à l’histoire du comté de Foix, à la construction au Moyen Âge, à l’histoire du château quand il était prison et à bien d’autres expositions temporaires.
Classement : Monument Historique depuis 1840
https://www.ariegepyrenees.com/decouvrir/incontournables/chateaux/le-chateau-de-foix/
Construction : XIIe siècle, restaurée au XVIIe.
Style : gothique
Caractéristiques : de l’église médiévale, il subsiste principalement le portail et la base des murs de la nef.
Histoire : des chanoines réguliers de saint Augustin prennent possession en 1104 d’une abbaye abritant les reliques de Saint-Volusien. Débute alors la construction d’une vaste église à trois nefs, comprenant un transept. Au XIVe siècle, le chevet roman est remplacé par un nouveau chœur de forme polygonale. L’édifice est ruiné pendant les Guerres de religion et ses reliques sont brûlées. Les travaux de reconstruction sont entrepris à partir de 1609, et sont vraisemblablement achevés vers 1670.
Signes particuliers : on y trouve un orgue romantique de 40 jeux construit par Leroy-Legendre & Fermis père & fils en 1869 et restauré par l’entreprise Lucien Simon et Jean-Pascal Villard en 2004. L’orgue de tribune, son buffet et sa partie instrumentale sont classés aux monuments historiques depuis 1997.
Classement : Monument Historique depuis 1964.
www.ariegepyrenees.com/foix/eglise-saint-volusien-a-foix/tabid/1018/offreid/72ff3a04-6581-4565-bb3e-0eb20c1004e1
Bien assis dans une barque, on suit la rivière de Labouiche, la plus longue rivière souterraine navigable d’Europe. Le parcours, long de quatre kilomètres, conduit dans les entrailles de l’Ariège, de salles en galeries ornées de multiples concrétions, en passant par la cascade Salette.
www.labouiche.com
La scène nationale l’Estive est un haut lieu culturel d’Ariège : elle propose plus de 40 spectacles par an à Foix et dans tout le département. L’Estive soutient la création artistique, met en place des actions de sensibilisation pour apporter la culture à toutes et tous. Elle gère également le cinéma « Art et Essai » à l’Estive Foix et le réseau itinérant « Ariège Images » dans tout le département.
https://www.lestive.com/
Pont fortifié à deux arcades, construit au XIIIe siècle. Comme tous les « Ponts du Diable », une légende s’y rapporte : l’architecte ayant pactisé avec le Diable ne pourrait finir la construction du pont qu’en échange de la première âme qui le traverserait. Mais plus malin que le Malin, il fit traverser… un chat.
Le Rebech, un stade d’eau viveLa qualité des installations, de l'encadrement et du site naturel du Rebech, aménagé spécialement pour la pratique des sports d’eau vive, font de Foix une plate-forme incontournable pour les divers championnats, mais aussi pour l’entraînement et les stages de perfectionnement. En 2010, Foix a accueilli les championnats du monde junior de canoë-kayak (slalom). Plus d’une quarantaine de nations participèrent à la compétition. En 2025, le site accueillera à nouveau l’élite mondiale des juniors et des espoirs pour les championnats du monde de canoë-kayak.
https://www.mairie-foix.fr/STADE-D-EAU-VIVE-DU-REBECH/202/
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France