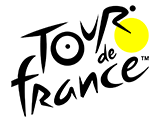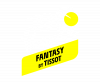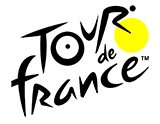AURILLAC
Festival du théâtre de rues
Création : 1986.
Histoire : le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac (Cantal) a été créé par le metteur en scène français Michel Crespin. À partir de la troisième édition en 1988, apparaît sur l’affiche du festival un personnage avec une expression du visage étonnée : cette illustration d’Henri Galeron est depuis présente sur les affiches de chaque édition. En amont du festival dans le cadre des Préalables, des compagnies présentent depuis 1999 leur spectacle dans certaines communes du département. En 2004, l’association Éclat, productrice du festival, crée Le Parapluie, un centre international de création artistique et de recherche ayant pour but de participer au rayonnement du théâtre de rue.
Caractéristiques : Aurillac est considéré comme le plus grand festival de théâtre et d’arts de la rue européen, très couru autant par un public appréciant son ouverture que par des professionnels, avec des centaines de spectacles accessibles gratuitement en plein air ou sous chapiteau, joués par quelque 600 compagnies venues du monde entier. Il a lieu chaque année pendant quatre jours, du mercredi suivant le 15 août au samedi. Il a vu sa fréquentation croître jusqu’à environ 200 000 spectateurs au cours des quatre jours du festival, qui aura lieu en 2026 du 20 au 23 août.
Château Saint-Étienne
Construction : IXe au XIXe siècle.
Style : médiéval et troubadour.
Caractéristiques : bâti sur une butte de 685 mètres, le château Saint-Étienne domine la ville. Du premier castrum il ne reste qu’une tour carrée, offrant sa masse imposante. Trois périodes de construction se distinguent : le IXe siècle à la base, le XIIe siècle, puis le XIVe siècle. L’arase supérieure date du XIXe siècle et une terrasse a remplacé l’ancienne toiture en pavillon du XVIIIe siècle. De plan carré, la tour s’élevait jusqu’en 1747 à plus de trente mètres, date à laquelle elle fut arasée. On pénétrait par une porte à sept mètres au-dessus du sol comme la tour de Saint-Simon qui appartenait aussi à l’abbaye, et de là on redescendait au rez-de-chaussée par une échelle. L’abbaye possédait un réseau d’autres tours bâties sur le même modèle, comme celles de Naucelles ou de Faliès. Le corps de logis qui se trouvait au pied de la tour a été détruit en 1868 par un incendie. Un vaste bâtiment a été reconstruit à l’initiative de Louis-Furcy Grognier dans le style du Palais des papes à Avignon. En effet, redécouvrant l’origine locale du pape Sylvestre II, une souscription municipale a été lancée pour lui ériger une statue, et le thème du palais des papes est devenu celui de l’architecte Juste Lisch.
Destination actuelle : le château Saint-Étienne était jusqu’en 2023 le site du musée la Maison des volcans et du centre d’étude et de protection de l’environnement de la Haute-Auvergne avec un laboratoire de recherche universitaire. Le musée a fermé dans l’attente de la mise en place d’un nouveau musée plus généraliste. Le château accueille depuis, au mois de juin, le festival Là haut la nuit.
Classement : inscrit Monument Historique depuis 2010. Site inscrit depuis 1974.
Église abbatiale Saint-Géraud
Construction : Xe au XIXe siècle.
Style : roman.
Caractéristiques : sur les éléments romans détruits à plusieurs reprises, la dernière restauration du XIXe siècle a complété la nef avec trois travées et un porche, et reconstruit à neuf le clocher. Le clocher actuel de l’abbatiale Saint-Géraud est la plus haute construction de la ville avec ses 77 mètres de hauteur.
Histoire : l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac est une ancienne abbaye bénédictine qui a été le modèle de celle de Cluny. Elle a été fondée avant 885 par le comte Géraud d’Aurillac. L’abbaye a été un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge. Elle avait également plus d’une centaine de dépendances et possessions, dont une quarantaine de prieurés allant de l’Auvergne jusqu’en Espagne et s’étendant sur une douzaine de diocèses.
Destination actuelle : lors de travaux de rénovation en 2013, des vestiges importants ont été découverts, qui ont conduit à un réaménagement du site, inauguré en septembre 2025.
Classement : inscrite Monument Historique en 1920 et 1942.
Haras national d’Aurillac
Construction : 1983.
Histoire : lors de la réorganisation des haras par Napoléon Ier en 1806, le dépôt d’étalons d’Aurillac est installé dans le couvent de la Visitation de la rue des Carmes. C’est également en ce début du XIXe siècle, en 1821, que les premières courses sont organisées à Aurillac. En 1973, les installations de la rue des Carmes s’avèrent de plus en plus exiguës pour les 47 étalons qui y vivent. C’est pourquoi un haras neuf est construit en 1983 au sud de la ville sur un domaine de 17 hectares, remis à l’État par le département du Cantal, à proximité de l’hippodrome et de l’école d’équitation, créant ainsi un pôle hippique d’une trentaine d’hectares dans la périphérie immédiate de la ville, auquel s’est ajouté un poney-club.
Préfecture du Cantal
Construction : XIXe siècle.
Style : néoclassique.
Caractéristiques : édifice construit de 1800 à 1806 sur les plans de l’ingénieur Lallié, puis achevé en 1814 par l’ingénieur Demets, représentant la première préfecture bâtie en tant que telle en France. De style néo-classique, il se compose d’un avant-corps à fronton sur la façade ouest et d’une rotonde, tous deux ornés d’un décor de pilastres doriques et de frise à métopes. L’intérieur de la rotonde abrite un salon Empire avec parquet en marqueterie étoile et coupole à caissons en stuc.
Classement : Monument Historique depuis 2004.
LE LIORAN
Plomb du Cantal (1855 m) Point culminant du département, site emblématique du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Accessible en randonnée par le GR 4 ou bien avec le téléphérique, il offre un exceptionnel panorama sur les sommets du Massif Central : Puy Griou, Puy Mary, Puy de Sancy...). Depuis le sommet, itinéraires enduro et de descentes VTT, aire d’envol pour les parapentes et différents circuits de randonnées.
Musée de l’agriculture auvergnate C’est dans une ferme du XVIIe siècle, au cœur du joli bourg de Coltines, que s’est installé le musée de l’agriculture auvergnate. Six salles d’exposition permettent une visite à la fois ludique et pédagogique.
« L’hiver » sert d’introduction avec une présentation du patrimoine architectural local ainsi que de magnifiques paysages enneigés. Se découvre alors l'intérieur de l’Ostal de la Marissou (la maison de la petite Marie), du nom de la dernière habitante des lieux, son cantou et divers objets que l’on trouvait dans les fermes d’autrefois. La visite se poursuit avec le printemps, puis l’été et l’automne. Plusieurs outils, témoins du savoir-faire d’antan sont présentés. En fin de parcours, des films et un diaporama retraçant la vie paysanne sont projetés.
Maison du Buronnier Le pastoralisme est une pratique ancestrale dans ces montagnes, le buron est le lieu où durant l’estive, les buronniers vivent et fabriquent le cantal. Le Buron de Belles Aigues, en activité jusque dans les années 60, a conservé toutes les pièces et outils permettant aujourd’hui de transmettre ce savoir-faire cantalien. Visites guidées tout l’été.
Église Saint-Pierre de Bredons
Construction : XIe siècle.
Caractéristiques : fortifiée, classée monument historique et possédant un des plus beaux porches de style roman, elle est dotée de stalles et de boiseries d’influence italienne, d’un riche mobilier de style baroque, dont le maître autel qui est l’un des plus majestueux de toute la Haute Auvergne.
Histoire : le prieuré est fondé en 1067 par Durand de Bredon, abbé de Moissac de 1048 à 1071. La consécration de la première église est faite en 1095. L’église a été victime de nombreux vols, le plus récent en 2002, quand une cinquantaine d’objets ont été dérobés, dont dix statues et un tableau. Ils seraient aux mains de collectionneurs peu scrupuleux.
Signes particuliers : est conservée au musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour l’une des rares statues-reliquaires en bois romanes bien conservées existant encore en France, provenant du riche trésor du prieuré de Bredons (statue retrouvée en 1954 par un enfant de Bredons, derrière le maître-autel de l’église, où elle avait été cachée plusieurs siècles plus tôt) : une statue-reliquaire en noyer, recouverte d’une polychromie et par endroit de plaques métalliques, qui date de la première moitié du XIIe siècle. Celle-ci représente saint Pierre, assis sur un trône et vêtu d’une tunique plissée, qui, de sa main gauche, avec ses deux doigts levés, bénit les fidèles.
Destination actuelle : l’église subit des travaux de restauration depuis 2021.
La Roche Percée La Roche Percée est une grotte et un habitat troglodyte médiéval se situant à flanc de falaise sur les hauteurs du hameau de Fraisse-Haut (commune de Laveissière) dans la vallée de l’Alagnon en Haute-Auvergne. Cet habitat troglodyte médiéval se divise en trois niveaux, taillés en ciseau, reliés par des escaliers. À proximité de l’entrée se trouve une demoiselle coiffée. La grotte a été sommairement sécurisée par la commune grâce à des rampes en fer facilitant la découverte de l’ensemble de la grotte. Son accès se fait soit depuis le PR jaune partant de Fraisse-Haut (250 mètres de dénivelé), soit depuis le GR 400 passant au-dessus et reprenant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Aucun document n'a été retrouvé à son sujet, mais certains indices laissent penser que son occupation remonte loin dans le temps. Elle servit de lieu d’ermitage pendant le Moyen Âge, notamment pour Saint-Calupan. Enfin, elle servit d’abri pastoral pour les bergers, jusqu’au début du XXe siècle où deux femmes l’occupaient.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France