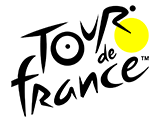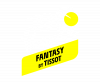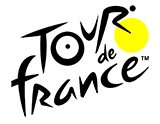GRANOLLERS
La Porxada (halle au grain)
Construction : 1586 et 1587.
Histoire et caractéristiques : la Porxada est un édifice composé d’une plate-forme en pierre, de 15 colonnes en pierre et d’un toit, ainsi que d’un sous-sol. Érigée entre 1586 et 1587 par le maître d’œuvre Bartomeu Brufalt à la demande du Conseil de la ville, elle est l’élément architectural le plus caractéristique et le plus emblématique de la ville de Granollers. Pendant la guerre civile espagnole, elle a été partiellement détruite lors d’un bombardement, puis reconstruite. Plus récemment, elle a été restaurée par le service du patrimoine architectural local de la Diputacion de Barcelona entre 1985 et 1986.
Classement : Monument historique et artistique depuis 2006.
Sala Francesc Tarafa (ancien hôpital de Sant Domènech)
Histoire : le bâtiment fut construit en 1329. En 1521, Pere de Clariana i de Seva en fit don à la ville afin qu’il soit transformé en hôpital… ce qui ne se produisit qu’en 1823. La nef gothique servait d’édifice religieux et l’hôpital se trouvait dans les maisons environnantes, aujourd’hui disparues. La mairie le fit rénover par l’architecte Joaquim Raspall et le céda à la Mancomunitat de Catalunya pour y installer une bibliothèque, qui fut inaugurée le 21 octobre 1926 par Alphonse XIII.
Caractéristiques : lors de la rénovation réalisée en 1926, le style gothique et les structures de l’ancien hôpital ont été respectés, des éléments décoratifs d’inspiration médiévale ont été ajoutés à la façade et les éléments néogothiques de l’intérieur ont été supprimés. À la place furent installés des motifs végétaux, des stucs et des vitraux, de style moderniste. La façade est conçue dans un style rappelant le gothique catalan. La salle gothique du bâtiment constitue l'exemple le plus important de l'architecture gothique de Granollers.
Classement : bien culturel d’intérêt local.
Clocher de l’église de Sant Esteve
Construction : XVe siècle.
Histoire et caractéristiques : le clocher est le seul vestige « in situ » de l’ancienne église gothique de Sant Esteve, construite au XVe siècle sur un bâti roman. L’église actuelle a été construite entre 1940 et 1942, après avoir été détruite pendant la guerre civile de 1936. Le musée de Granollers possède des encorbellements et des chapiteaux provenant de l’église gothique.
Résidences gothiques et Renaissance
Construction : XVIe siècle.
Caractéristiques : la place de la Porxada abrite quelques bâtiments uniques et notamment deux hôtels particuliers du XVIe siècle. Le numéro 28 est un bâtiment représentatif de l’architecture des XVIe et XVIIe siècles. Il reçut certaines rénovations au cours des 25 premières années du XXe siècle, mais ses origines anciennes n’en furent pas dénaturées. La date 1541 est inscrite sur l’une des entrées du rez-de-chaussée. La résidence du numéro 30 date du XVIe siècle et fut rénovée dans les années 1970. Elle comporte actuellement trois fenêtres d’origine de style gothique/Renaissance, où l’on peut voir avec précision plusieurs silhouettes d’anges et visages de femmes et de chevaux.
Adoberia dels Ginebreda (tannerie)
L’Adoberia, centre d’interprétation historique de la Granollers médiévale propose une muséographie singulière qui permet de découvrir un complexe artisanal préindustriel, ainsi que l’histoire et le développement de la ville de Granollers du IXe au XVIIIe siècle.
LES ANGLES
Station de sports d’hiver
En 1961, 250 habitants habitaient le village dont l’agriculture et le pastoralisme étaient les principales activités. Le conseil municipal, sous le mandat de Paul Samson, prend la décision de développer le ski sur un terrain s’étendant du Pla Del Mir à Péborny.
Le village des Angles possède aujourd’hui un domaine skiable de 55 km ouvert en hiver, deux écoles de ski et des sentiers nordiques pour les balades en raquette et les randonneurs de 40 km. La station possède aussi une activité découverte : une descente en luge sur rail, avec des pointes de vitesses à plus de 40 km/h. La station a adapté ses infrastructures pour accueillir l'été une population de vététistes, en particulier pour son bike park avec des pistes aménagées pour le VTT de descente.
Église Saint-Michel des Angles
Construction : XIXe siècle.
Style : néo-roman.
Caractéristiques : elle est construite au XIXe siècle dans un style néo-roman. On y trouve un retable de la Nativité du XVIIe siècle. Le retable de l’Épiphanie et de l’adoration des rois mages, situé à droite en entrant, date du XVIIIe siècle. Il provient de l’ancienne église Saint-Sauveur.
Classement : le retable du XVIIIe siècle est classé monument historique au titre objet depuis 2000.
Église Sainte-Marie de Vallsera
Construction : XIe siècle.
Style : roman.
Histoire et caractéristiques : l’ancien village de Vallsera a aujourd'hui disparu. Selon la tradition, l’église et le hameau de Balcère ont été décimés par la peste noire au XIVe siècle. Deux sœurs survivantes ont été recueillies aux Angles, et depuis ce temps ce territoire qui appartenait à la paroisse de Formiguères serait passé à celui des Angles. En réalité, c’est en 1701 que l’abbaye Saint-Michel de Cuxa a cédé la devèse de Vallsera aux Angles.
Classement : le retable, transféré dans la nouvelle église Saint-Michel, est classé monument historique au titre objet depuis 2000.
Refuge des Bouillouses
Construction : 1903
Histoire : construit pour héberger les ouvriers qui travaillaient à la construction du barrage des Bouillouses entre 1903 et 1910, le bâtiment prend une vocation touristique dès 1920. Il est géré un temps par le Club alpin français à partir de 1991. Devenu propriété de la Communauté de communes Pyrénées catalanes, le refuge a été rénové et équipé de 2018 à 2022 à hauteur de 1,5 million d'euros et a rouvert en décembre 2022.
Caractéristiques : c'est un refuge gardé ouvert neuf mois, de décembre à avril et de mai à octobre qui offre 46 places en chambre ou dortoir et 12 en hiver, période au cours de laquelle il est « semi-gardé » dans la partie réservée aux randonneurs à ski. Le refuge est une base d’excursions, en randonnée pédestre et VTT de moyenne montagne, notamment vers les pics Carlit (2 921 m) à l'est et Peric (2 810 m) au nord, les sommets et étangs d’altitude proches comme les étangs du Carlit.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France