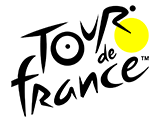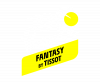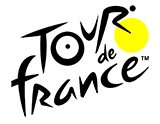Région Auvergne-Rhône Alpes
Départements : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Métropole de Lyon, Savoie, Haute-Savoie.
Population : 8,2 millions d’habitants
Préfecture : Lyon
Superficie : 69 711 km2
Spécialités : Vins du Beaujolais, des côtes du Rhône et de Savoie, spécialités lyonnaises (quenelles, cervelles de canut, saucisson…), potée auvergnate, spécialités savoyardes (raclette, fondue, tartiflettes, diots, crozets), fromages (beaufort, reblochon, cantal, bleu d’Auvergne, Salers, saint-Nectaire…), lentille verte du Puy, eaux (Évian, Thonon, Volvic) verveine, chartreuse.
Clubs sportifs : Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne, Clermont Foot 63, Grenoble Foot 38 (football). ASM Clermont, Lyon OU, FC Grenoble, Stade Aurillacois, US Oyonnax (rugby), ASVEL Villeurbanne (basket), Chambéry (handball), Brûleurs de loup Grenoble, Pionniers de Chamonix (hockey-sur-glace)
Compétitions : Coupe du monde de football féminin, compétitions de ski (critérium de la Première neige à Val d’Isère), cols du Tour de France, Critérium du Dauphiné.
Économie : (8e région européenne) industries de pointe, automobile (Berliet), métallurgie, caoutchouc, plastiques, chimie, électronique, agroalimentaire, textile, numérique, banques, universités, administrations, viticulture. Pneumatiques (Michelin). Design. Nouvelles technologies (Inovallée). Tourisme d’hiver et d’été.
Festivals : Fête des Lumières à Lyon / Nuits de Fourvière à Lyon / Quais du polar à Lyon / Biennale du design à Saint-Etienne / Festival de musique classique de La Chaise-Dieu
Sites touristiques : Vieux Lyon et Croix-Rousse, cathédrale du Puy-en-Velay, lac d’Annecy, château de Chambéry, sports d’hivers en Isère, Savoie et Haute-Savoie, Cantal, Stations thermales, volcans d’Auvergne. Caverne du Pont d’Arc. Château de Grignan. Bastille de Grenoble. Vulcania. Parc des Oiseaux.
Sites web et réseaux sociaux : www.auvergnerhonealpes.fr
ALLIER (03)
Population : 333 298 hab.
Préfecture : Moulins.
Sous-préfectures : Montluçon, Vichy.
Superficie : 7 340 km2
Nombre de communes : 317
Spécialités : Pâté aux pommes de terre, viande charolaise, andouillette, vins de saint-pourçain (AOC), chambérat du Bourbonnais, moutarde de Charroux, moulinois, vérités de Lapalisse et pastilles de Vichy.
Grands clubs sportifs : Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne, Montluçon Football (football masculin), Yzeure Allier Auvergne (football féminin), Jeanne d’Arc de Vichy Val d’Allier (basket). FC Moulinois (rugby). Ligier (automobile).
Compétitions : Ironman Vichy, Vin’Scène en Bourbonnais, Foulée vichyssoises (course pédestre),
Sites touristiques : Thermalisme : Vichy, Néris-les-Bains ; château de Lapalisse et ses célèbres plafonds à caissons Renaissance, château de Bourbon-l'Archambault, « berceau des Bourbons », Grand Casino de Vichy, beffroi Jacquemart de Moulins, château de Chareil-Cintrat, la route historique des châteaux d'Auvergne ; églises et abbayes : cathédrale de Moulins et le triptyque de la Vierge en gloire, église prieurale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Souvigny.
Musées : Centre national du costume de scène, musée de la Visitation et de la Vie bourbonnaise, musée Anne-de-Beaujeu, musée de l'illustration jeunesse (MIJ), musée du Bâtiment et Maison Mantin à Moulins, musée Augustin-Bernard à Bourbon-l'Archambault, musée des Musiques populaires (Mupop) à Montluçon, musée des Arts d'Afrique et d'Asie à Vichy, musée de la Vigne et du Terroir à Saint-Pourçain-sur-Sioule, musée de Souvigny, Historial du paysan soldat à Fleuriel, Street Art City à Lurcy-Lévis.
Villages : Charroux, Hérisson, Souvigny et Verneuil-en-Bourbonnais.
Festivals : Jazz dans le bocage, Jazz au fil du Cher, Musiques Vivantes, Opéra de poche, Journées musicales d’automne de Souvigny, Frstival de musique des Monts de la Madeleine, Festival de Musique en Boubonnais, Festival lyrique en Tonçais.
Économie : L'agriculture occupe encore une grande part du marché de l'emploi. S'y ajoutent le tourisme et le thermalisme. L'industrie est très présente, principalement avec la métallurgie, la construction mécanique, le matériel électrique et la fabrication de denrées alimentaires, mais aussi avec les produits en caoutchouc et en plastique, ce qui totalise la moitié des emplois industriels du département. La filière mécanique/électronique/informatique/automatique/plasturgie compte des grands groupes comme Sagem-Safran, Potain-Manitowoc, PSA Peugeot Citroën, Dunlop Goodyear (à Montluçon), Erasteel-Eramet, Amis, Bosch (à Yzeure). Son développement s'appuie sur le pôle de compétitivité Viameca et sur les formations techniques locales (Montluçon).
La filière bois, liée à la sylviculture locale, compte des groupes leaders comme Berry Wood, Chignac Bois et scierie, Ets Canard, Ets J. Bourdier, Ets Roy et Fils, Fournel Emballages, Menuiserie Charpente Philippe Guillaumin, Menuiserie Dutour, Office national des forêts, Sedec, Sefic, Stand Expo Deco, Tonnerre.
La filière agroalimentaire s'appuie sur la forte tradition agricole locale, la qualité et le haut de gamme, principalement autour de l’eau et de la viande ainsi que le pôle de compétitivité d’envergure internationale Céréales Vallée. Elle compte de grands groupes industriels (Alliance Bigard Charal, Compagnie de Vichy, Épicentre, Kraft Food, Ldc, Sicarev, Société commerciale des eaux du bassin de Vichy…) et de nombreuses PME (Allier Volailles, Convivial, Pouzadoux, Puigrenier, Sicaba…).
La filière nutrition-santé compte une dizaine de sociétés actives dans la fabrication, l’emballage et le conditionnement et les biotechnologies, groupées dans une association (Nutravita). Elle bénéficie du dynamisme du Parc Naturopôle Nutrition santé et du BioParc de Vichy (L'Oréal Cosmétique à Vichy).
Sites web / FB : www.allier.fr, www.allier-auvergne-tourisme.com, Twitter : @Allierdpt
Km 4.4
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (3 580 hab.)
Le village s’est développé autour de son prieuré clunisien dépendant de l’abbaye de Mozac. L’humoriste Fernand Raynaud, extrêmement populaire dans les années 1960, est inhumé dans le cimetière de la commune, où il passait ses vacances depuis son enfance. Le créateur du sketch du 22 à Asnières s’est tué en 1973 à l’âge de 47 ans dans un accident de la route au volant de sa Rolls-Royce près de sa ville natale de Riom. Il avait consacré un sketch à la passion de la bicyclette baptisé Moi, mon truc, c’est le vélo.
Église Notre-Dame
Construction : XIIe siècle.
Style : Roman.
Histoire et caractéristiques : Elle fait partie de l’ancien prieuré rattaché à l'ordre de Cluny et qui dépendait de l'abbaye de Mozac. Il bénéficiait des droits de justice civile et criminelle. de l'église, de style roman, est surmontée d'un clocher coiffé d'un dôme à impériale. La nef comporte trois travées et elle est munie de bas-côtés. Le transept n'est pas saillant. Le chevet est constitué d'une abside flanquée de deux absidioles. Une chapelle latérale date du XVe siècle. C'est dans l'absidiole nord qu'était installée la statue de la Vierge, objet d'un pèlerinage le 2 juillet, avant qu'elle ne soit transférée dans la nouvelle basilique. Elle abrite des peintures murales du XIIIe siècle.
Classement : Classée Monument historique en 1969.
Km 12.2
BILLY (820 hab.)
Durant le Haut Moyen Âge, un premier castrum entouré d'habitations constitue l'embryon de la future commune qui se développe au XIIe siècle quand est érigée une forteresse bientôt possession des seigneurs de Bourbon, autour de laquelle la cité bénéficie d'un statut de « ville franche ». Conjuguée à l'activité liée au commerce fluvial, cette disposition assure à Billy une réelle prospérité qui s'étiole à compter des guerres de Religion. Entre-temps, le bourg entourant le château et l'autre pôle du village, près de l'église, ont été reliés. Il demeure de ce riche passé un patrimoine exceptionnel, outre les vestiges du château lui-même. À tel point que la localité a obtenu en 2021 le label "Petite cité de caractère".
L'ensemble du bourg de Billy, bâti autour de son château médiéval, est un site inscrit depuis 1975.
Château de Billy
Construction : XIIIe au XVIe siècles.
Style : Château-fort
Histoire : Édifié à partir de la fin du XIIe siècle sur une butte dominant le cours de l'Allier depuis sa rive droite, il fut le siège d'une châtellenie qui, à son apogée au début du XVIe, avait pouvoir sur 62 paroisses et 3 seigneuries. Dotée de cinq tours d'enceinte demi-circulaires, de larges murailles hautes de 10 m ornées de boucliers et de meurtrières, la forteresse fut longtemps réputée imprenable. Avec sa porte monumentale, ses deux tours massives, des fossés et un ensemble d'enceintes puis l'ajout d'une tour de guet, l'édifice a défié le temps, même s'il a subi des destructions lors des guerres de religion. Passé du duché de Bourbon au domaine royal, il ne fut pas démantelé par Richelieu. Après son âge d'or, le château devient prison puis sert de carrière de pierre. Il est restauré par des bénévoles à compter des années 1960. Il comprend en annexe une résidence seigneuriale du XIVe siècle, plus confortable que la tour principale.
Classement : Classé Monument historique en 1921.
Km 15.1
MERCENAT (380 hab.)
Sur le territoire de la commune se trouve le château de Lonzat, où résidait l’été le maréchal Pétain pendant l’Occupation. Au printemps 1944, à l'approche d'un débarquement allié, les Allemands, craignant un enlèvement ou une fuite, l'obligèrent à résider au château, qui était alors protégé par deux cents soldats de sa garde personnelle dans le parc du château et par 1 500 soldats allemands aux alentours.
Km 26.3
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Réputée pour son vignoble AOC dont l'origine remonte à l'Antiquité, la petite ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, fondée au Ve siècle autour d'un ancien monastère, abrite un patrimoine intéressant, comme l'accueillante place du Maréchal Foch, dominée par la silhouette de la tour de l'horloge, l'église de style romano-gothique, la jolie cour des Bénédictins et le musée consacré au vignoble saint-pourcinois.
C’est en 1987, que la Confrérie des Compagnons de la Ficelle vit le jour. Elle perpétue la tradition par laquelle Gaultier, un tavernier de Saint-Pourçain du XVe siècle, servait son vin dans des pichets de terre. Ne voyant pas la consommation de ses clients, il eut l’idée ingénieuse de faire des nœuds réguliers sur une corde qu’il trempait dans les pichets de vin pour voir ce qu’il restait. Cela fait maintenant 38 ans que Saint-Pourçain fête la sortie de la ficelle le premier samedi du mois de décembre.
En 2024, la ville avait accueilli le départ du Critérium du Dauphiné et Mads Pedersen s’était imposé devant Sam Bennett. En 2013, Saint-Pourçain-sur-Sioule était départ d’une étape du Tour de France remportée à Lyon par Matteo Trentin. Une étape du Tour de l’Avenir 2010 s’était enfin élancée dans ce haut lieu de la viticulture. C’est à l’occasion de cette course que la nouvelle génération des coureurs colombiens, emmenée par Nairo Quintana, vainqueur de l’épreuve, avait commencé à s’exprimer sur la scène internationale.
Tour de l’horloge ou du beffroi
Construction : XVe siècle.
Histoire : Érigée en 1480 sur l'une des anciennes tour de l'enceinte monastique, elle sert tout d'abord de tour de guet. Elle est ensuite équipée d'une horloge avec sa cloche par les habitants. À l'intérieur de cette tour, se déroule un escalier en colimaçon que l'on peut admirer depuis la maison du bailli qui abrite les collections du Musée de la Vigne ; ce dernier consacre l'une de ses salles à l'histoire de la ville.
Classement : Inscrite Monument historique en 1986.
Église Sainte-Croix
Construction : XIe et XVe siècle.
Style : Roman et gothique.
Caractéristiques : L'ancienne prieurale Sainte-Croix, aujourd'hui paroissiale, est un vaste édifice qui nécessita plusieurs campagnes de construction. Elle présente un porche datant du début de l'époque romane au-dessus duquel s'élève le clocher. La nef gothique est couverte d'une charpente en carène de vaisseau. À l'intérieur, le visiteur admirera surtout le chœur dont le rond-point comporte des arcs aigus très élégants. Le porche nord a conservé les niches et les bases de ses anciennes statues-colonnes détruites à la Révolution. Les stalles de moines bénédictins du XVe siècle, la statue de l'Ecce homo en pierre polychrome de la fin du XVIe siècle et le maître autel du XVIIIe siècle constituent les plus beaux objets conservés à l'intérieur de cette église qui possède aussi un orgue Cavaillé-Coll du XIXe siècle.
Classement : Classée Monument historique en 1875.
Musée de la Vigne et du Terroir
Construction : XVIe siècle.
Caractéristiques : Le musée, qui est installé dans la maison du Bailli (XVIe siècle), dans la cour des Bénédictins, propose plus d'une dizaine de salles à découvrir pour connaître le vignoble saint-pourcinois et son histoire : outillage du vigneron et des artisans en rapport avec la vigne, techniques viticoles, vie quotidienne.
Km 36.5
MONÉTAY-SUR-ALLIER (540 hab.)
Château de Lagrillère
Construction : XIXe siècle.
Style : Anglicisant.
Histioire et caractéristiques : Cet édifice en brique rouge fut construit à la fin du XIXe siècle lorsque Stephen Durieu de Lacarelle, revenant d’un voyage en Ecosse décide d’abandonner son château de Logères pour faire construire un bâtiment dans le style anglicisant des années 1900. Le projet initial est conçu par Jean Moreau, poursuivi en 1899 par son fils, René, en collaboration avec le propriétaire qui conçoit lui-même plans, projets de façades et d’aménagement. Les décors intérieurs sont exécutés par le sculpteur Thiébaud et le peintre décorateur Germain Détanger. Le grand et le petit salons, séparés par des colonnes à chapiteaux corinthiens s’ornent de stucs et de boiseries dans l’esprit du XVIIIe siècle. La bibliothèque fumoir, le cabinet de travail et la salle à manger aux boiseries surmontées de scènes mythologiques sont en partie récupérés au château de Logères. À l’étage, les chambres sont décorées et meublées dans des styles différents. L’élément intérieur le plus remarquable est l’escalier monumental en marbre rose de style Renaissance. Le parc est redessiné à la même époque.
Classement : Classé Monument historique en 1990.
Km 38.7
CHÂTEL-DE-NEUVRE (560 hab.)
Église Saint-Laurent
Construction : XIe et XIIe siècles.
Histoire et caractéristiques : L'église Saint-Laurent a été érigée entre le XIe et le XIIe siècle. D'architecture romane, elle dévoile notamment une belle peinture murale du XVe siècle représentant saint Sébastien dans sa chapelle nord. Construite sur une butte, elle offre un beau point de vue sur la rivière et ses alentours. Considérée comme l'une des plus anciennes du département, elle présente une nef étroite.
Classement : Classée Monument historique en 1927.
Km 48.3
CHEMILLY (580 hab.)
Église Saint-Denis
Construction : XIe et XIIe siècles.
Histoire et caractéristiques : Elle date de la dernière période romane bourbonnaise. En 1152, l'église appartenait à l’ancien diocèse de Bourges. L’édifice a des proportions harmonieuses. La nef à trois travées, couverte en berceau brisé, est flanquée de bas-côtés voûtés d’arêtes. Le portail, en ressaut, est surmonté d’une archivolte à trois voussures, et les piédroits sont formés de colonnettes à chapiteaux sculptés. À l’intérieur de l’église, se trouve une Vierge à l’Oiseau. Originale statue en bois polychrome datant du XVe siècle, elle a été restaurée en 1987. Une seule cloche se trouve aujourd’hui dans son clocher carré comprenant deux étages.
Classement : Classée Monument historique en 1910.
Km 55.7
MOULINS (20 000 hab.)
Préfecture de l'Allier, la ville d'Art et d'Histoire de Moulins offre aux amateurs de patrimoine architectural et culturel un bel héritage, témoin de son glorieux passé d'ancien duché de la famille des Bourbons.
De nombreux attraits sont à y découvrir : La cathédrale Notre-Dame, avec son célèbre triptyque du maître de Moulins, représentant le couronnement de la Vierge, et ses vitraux des XVe et XVIe siècles ; le donjon de la Mal Coiffée, vestige de l'ancien château ducal ; le beffroi du XVe siècle, surmonté d'un jacquemart ; les maisons anciennes du centre historique, dont certaines sont ornées de pans de bois ; le pavillon Renaissance Anne de Beaujeu des XVe et XVIe siècles... Vestige du palais ducal, ce dernier abrite le musée Anne de Beaujeu, réputé pour ses remarquables collections d'archéologie, de sculptures médiévales, de peintures flamandes, allemandes et autrichiennes, et de peintures académiques du XIXe siècle.
En 2023, Moulins était la seule préfecture métropolitaine à ne pas avoir accueilli le Tour de France au cours de ses cent-vingt années d’existence. Cette anomalie fut rectifiée avec une victoire au sprint de Jasper Philipsen. Mais le chef-lieu de l’Allier avait d’autres références cyclistes à faire valoir. Il a ainsi reçu le Critérium du Dauphiné et Paris-Nice la même année, en 1957. Natif de Moulins, Jean-Pierre Bourgeot a participé à quatre Tours de France entre 1993 et 1996. Angelo Tulik, autre enfant du pays, a pour sa part disputé les Tours 2015, 2016 et 2017.
Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation
Construction : XVe siècle puis XIXe siècle.
Style : Gothique flamboyant, néogothique.
Histoire : Le chœur est de style gothique flamboyant du XVe siècle en grès jaune orangé de Coulandon. La nef et les flèches néo-gothiques rayonnent avec le mélange du calcaire blanc de Chauvigny et de quelques pierres noires de Volvic, de style gothique du XIIIe siècle considéré alors comme le plus pur par les architectes du XIXe siècle. Les travaux d'achèvement de la cathédrale, entrepris dans les années 1850 par les architectes Lassus et Millet, furent abandonnés. La cathédrale fut finalement achevée dans les années 1880 sur des plans plus modestes. Ses deux flèches mesurent 82 mètres mais paraissent plus hautes du fait que le parvis de la cathédrale domine l’Allier d’environ vingt mètres.
Signes particuliers : La cathédrale abrite le célèbre triptyque du Maître de Moulins (Jean Hey). Ses orgues de tribune de Joseph Merklin (1880) sont classées aux Monuments Historiques depuis 197584. La cathédrale abrite également un orgue de chœur signé John Abbey.
Classement : Classée Monument Historique en 1875.
Triptyque du Maître de Moulins
Création : 1502
Style : Gothique et Renaissance.
Classement : Classé Monument Historique en 1898.
Caractéristiques : Le triptyque est attribué au « maître de Moulins ». Après une longue période de débat concernant l'identité de celui-ci, Il est maintenant identifié avec une quasi-certitude comme le peintre d'origine flamande Jean Hey, dont la première œuvre connue est la Nativité conservée à Autun, au musée Rolin. Ce triptyque de la cathédrale de Moulins, daté de 1502, est dans un excellent état de conservation. Il représente la Vierge de l'Apocalypse, en compagnie des donateurs, le duc Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu, avec leur fille Suzanne. Cette œuvre présente des éléments charnières entre la tradition gothique assez tardive et la Renaissance qui advient.
Musée Anne de Beaujeu
Construction : 1500
Ouverture du musée : 1910.
Caractéristiques : Ses collections regroupent 20 000 œuvres, objets d’art, trouvailles archéologiques, pièces de monnaie, éléments d’éperonnerie, armes et un fonds d’histoire naturelle classées en cinq thématiques : archéologie, histoire des Bourbons, peinture germanique et flamande du XVe siècle, arts décoratifs du XVIIIe siècle, peinture et sculpture du XIXe siècle.
Histoire : Le musée est installé sur le site du château des ducs de Bourbon, dans le pavillon dit « Anne de Beaujeu », depuis 1910. Le pavillon est construit vers 1500 et ferme la grande cour du château médiéval. Il est un exemple précoce de l’architecture Renaissance en France. Le musée actuel doit beaucoup à l’ancien sous-préfet Louis Mantin, qui possédait une villa adossée au château. Il a légué sa maison, ses collections et une somme d’argent pour la fondation d’un musée dans le pavillon Anne-de-Beaujeu.
Classement : Classé Monument Historique en 1840. Musée labellisé Musée de France.
Km 59.6
YZEURE (12 900 hab.)
Avec près de 13 000 habitants, c’est la cinquième ville la plus peuplée de l’Allier. En 2019, Sam Bennett y avait enlevé la troisième étape de Paris-Nice devant Caleb Ewan et Fabio Jacobsen.
Église Saint-Pierre
Construction : À partir du IXe siècle.
Style : Roman.
Caractéristiques : Elle remonte au IXe siècle et fut transformée au cours des siècles suivants. L'ornementation de sa façade du XIIe est remarquable. Le portail d'influence bourguignonne présente des chapiteaux ornés de monstres de motifs antiquisants et de modillons à décor fantastique. Dans la nef et les bas-côtés, 32 chapiteaux du XIIe sont sculptés de rinceaux et de végétaux. Elle renferme un mobilier exceptionnel comme les bancs d'œuvre des corporations, les nombreuses statues classées des XIVe, XVe, XVIe siècles et la chaire datant de 1623.
Classement : Classée Monument historique en 1914.
Château de Panloup
Construction : XVIIe siècle.
Style : Classique.
Caractéristiques : Élégante demeure seigneuriale du XVIIe siècle dont les tours à lanternons se détachent gracieusement sur les arbres du parc qui l'entoure. La porte menant à l'ancienne chapelle est surmontée d'un linteau à bâtière du XIIe ou XIIIe siècle représentant l'Agneau pascal.
Destination actuelle : Ce château aux briques polychromes appartient à la ville et sert de lieux d'expositions et d'accueil de loisirs. Les extérieurs se visitent librement.
Classement : Inscrit Monument historique en 1947.
Région Bourgogne-Franche Comté
Départements : Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort
Population : 2,8 millions d’habitants
Préfecture : Dijon
Superficie : 47 784 km2
Spécialités : Vins de Bourgogne et du Maconnais, vins du Jura, fromages (Comté, Mont d’Or, morbier, bleu de Gex, cancoillotte), bœuf bourguignon, volaille de Bresse, kir.
Clubs sportifs : FC Sochaux-Montbéliard, AJ Auxerre, FC Gueugnon (football), Elan sportif chalonnais, JDA Dijon (basket), Jeanne d’Arc Dijon (handball).
Compétitions : Courses automobiles sur le circuit de Dijon-Prenois, cyclosportive la Franck Pineau à Auxerre
Économie : Automobile (Peugeot-Montbéliard), Alstom, General Electric (ferroviaire), sidérurgie, mines, parachimie, industrie pharmaceutique, électronique, plasturgie, papeterie, industries mécaniques et automobiles, agriculture (céréales, betterave, élevage bovin, fromages). Sylviculture. Horlogerie. Tourisme.
Festivals : Eurockéennes de Belfort, ventes des hospices de Beaune, Grandes heures de Cluny, Rencontres musicales de Vézelay, Ecrans de l’aventure à Dijon, Foire internationale et gastronomique de Dijon, Fenêtres sur courts à Dijon. Bicentenaire Courbet. Festival de musique ancienne de Besançon.
Sites touristiques : Abbaye de Fontenay, basilique de Vézelay, chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, vignoble de Bourgogne, citadelle de Besançon, Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon, saline royale d’Arc-et-Senans, cathédrale d’Autun, château de Guédelon, hospices de Beaune, citadelle et Lion de Belfort, abbaye de Cluny, ballon d’Alsace, roche de Solutré.
Sites web et réseaux sociaux : www.bourgognefranchecomte.fr
NIÈVRE (58)
Population : 201 417 habitants, répartis sur 17 cantons et 309 communes.
Préfecture : Nevers (32 990 h.).
Sous-préfectures : Cosne-Cours-sur-Loire, Clamecy, Château-Chinon
Spécialités : Faïences. Grès. Nougatines. Pavés de la route bleue. Pouilly Fumé (AOC), Coteaux du Giennois, viande charolaise, andouillette de Clamecy, Jambon du Morvan, fromage de vache Le Nivernais, fromage de chèvre Le Cosne, brasseries artisanales...
Sport : Uson rugby (pro D2), Circuit automobile Nevers-Magny-Cours, ESL Canoë-kayak
Festivals/Culture : Cité des Présents qui englobe le musée du costume et le Musée du septennat à Château-Chinon (ouverture en 2026), Musée de La Machine, Musée Grasset, Musée des Forges Royales à Guérigny, Bibracte. Djazz, Fête de l’accordéon Luzy.
Sites touristiques : Circuit automobile Nevers-Magny-Cours, cathédrale Saint Cyr Sainte Julitte (2 cryptes), église romane Saint Etienne, église Sainte Bernadette, Sainte Bernadette, Parc Naturel Régional du Morvan, Panorama du Bec d’allier, table d’orientation à Bibracte, espaces naturels sensibles, sculpture de César (Clamecy)...
Économie : Agriculture, technopôle de Magny-Cours, textile, artisanat....
Sites Internet : nievre.fr, https : //citedespresents.nievre.fr/
Km 90.3
DECIZE (4 930 hab.)
Posée sur une île rocheuse de la Loire, au carrefour de voies navigables, l'ancienne cité fortifiée de Decize offre à ses visiteurs une halte riche en découvertes patrimoniales. En témoignent les tours des remparts, vestiges de l'enceinte médiévale ; l'agréable Promenade des Halles, une longue allée ombragée de superbes platanes et tilleuls ; les ruines de l'ancien château des comtes de Nevers ; la tour de l'Horloge, agrémentée d'une statue du légiste Guy Coquille ; l'église Saint-Aré, dotée d'un chœur du XIe siècle et d'une crypte mérovingienne du VIIe siècle.
C’est la ville natale du romancier Maurice Genevoix (1890-1980), combattant de la Grande Guerre et académicien.
Paris-Nice fit étape à Decize en 1963 pour une première étape remportée au sprint par Rik Van Looy devant Rudi Altig et Jean Stablinski.
Église Saint-Aré
Construction : XI et XIIe siècles.
Style : Roman.
Histoire : L'église Saint-Aré de Decize est dédiée à l'ancien évêque de Nevers (548-558) qui avait souhaité être déposé dans une barque et enterré là où elle s'arrêterait. Selon la légende, cette dernière aura remonté le fleuve jusqu'à Decize. Édifiée entre le XIe et le XIIe siècle, elle a uniquement conservé de cette période son chœur et ses absides. Profondément modifiée entre le XVe et le XIXe siècle, l'église Saint-Aré est également dotée d'une crypte autrefois construite autour d'une grotte et d'un ancien temple gallo-romain. C'est dans cet espace classé aux Monuments Historiques qu'une statue de la Vierge, Notre-Dame de Sous-Terre aurait été vénérée pour ses miracles.
Classement : Classée Monument historique en 1875.
Km 99.5
LA MACHINE (3 200 hab.)
La commune est connue pour son passé de cinq siècles d'exploitation charbonnière (du XIIIe siècle à 1974), elle tire par ailleurs son nom d'un manège installé par des ouvriers liégeois en 1689 pour remonter la houille.
Musée de la Mine
Fondation : 1983.
Histoire : Le charbon a été pendant près de deux cents ans la principale ressource de la ville de La Machine. Son exploitation, contrôlée après 1865 par la compagnie Schneider et Cie, a entraîné le forage de puits de mine, la construction de plusieurs cités ouvrières et le recrutement de milliers de « gueules noires ». Au moment de la fermeture du dernier puits en 1974, de nombreux mineurs ont voulu garder la mémoire de leur métier en créant un lieu éducatif et pédagogique.
Caractéristiques : Ouvert depuis 1983, le musée de la Mine est composé de trois sites ; d'un côté, un musée, installé dans l'ancien siège administratif des « Houillères », retrace l'histoire du charbon et la vie des mineurs (le fond, le casse-croûte, les drames, les loisirs, etc). Le musée abrite les objets, photos, maquettes déposés par les anciens mineurs ; à quelques centaines de mètres se dresse le chevalement sur son carreau de la mine, son parc à matériaux, la salle de la machine d'extraction et la lampisterie ; sous le carreau, l'ancienne galerie de mine-école a été transformée en un lieu de découverte.
Classement : Musée de France.
Km 121.5
BILLY-CHEVANNES (330 hab.)
Église Saint-Martin
Construction : 1100
Style : Roman
Histoire : L’église Saint-Antoine de Chevannes, dont une partie de la construction peut remonter à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle ; a subi en 1982 un grave dommage. Une partie d’une poutre maîtresse de la charpente ayant cédé, la toiture de la nef s’est écoulée. L’édifice avait déjà nécessité à deux reprises au moins des réparations dont celle du chœur en 1689. On n’avait pas alors rétabli l’arc de pierre de l’état ancien, mais un ensemble curieux constitué par une énorme poutre reposant sur les impostes de murs qui renforcent les pilastres de l’ancienne arcade. De 1787 date la réfection du mur pignon du portail, la construction des deux arcs-boutants de la façade et des six de la nef. Un clocher de charpente, en avant du chœur, s’est écroulé au XIXe s.
Signe particulier : L’église possédait un bel ensemble de statues transportées à l’église de Billy ainsi qu’une cloche en bronze datée de 1511. Une Vierge en bois du XIIe s. est conservée à la Porte de Croux à Nevers.
Classement : Classée Monument historique en 1989.
Km 126.3
SAINT-BENIN-D’AZY (1 260 hab.)
Richard Marillier, qui fut directeur adjoint du Tour de France de 1981 à 1990, a été élevé par sa grand-mère à Saint-Benin-d’Azy. Ancien résistant et officier des forces spéciales, il devient directeur technique national et sélectionneur des équipes de France sur route en 1968 et le reste jusqu’en 1981. C’est sous sa houlette que Bernard Hinault est champion du monde en 1980. Entre 1989 et 1991, il fut également président de la Ligue nationale de cyclisme. Créateur du Tour Nivernais Morvan, il dirigea l’épreuve de 1991 à 1996. Il est décédé en 2017.
Château d’Azy
Construction : XIXe siècle.
Histoire : Le château est construit par le comte Denis Benoist d'Azy en 1847, après avoir laissé le château du Vieil Azy à son cousin. Il est l'œuvre de l'architecte angevin Pierre-Félix Delarue, qui réalise une demeure de style néo-classique.
Caractéristiques : Le château comporte un vaste corps rectangulaire, flanqué de quatre tours octogonales à toits pentus et d'une tour en fer à cheval sur le côté sud. Les pièces sont vastes et lumineuses. Un escalier de pierre avec une rampe à balustres et à pilastres finement ouvragés dessert le premier étage à partir du hall d'entrée recouvert d'un carrelage bicolore de très belle facture. Sur la façade apparaissent des décors industriels au fronton cintré des grandes baies représentant une locomotive, des pioches, une charrue et une forge symboles de la fierté de cet industriel.
Signe particulier : On trouve des dessus-de-porte peints par Van Loo ou Boucher, ainsi que des panneaux de papier peint représentant La chasse, provenant de l'Exposition universelle de 1851 à Londres, ornant la salle à manger.
Classement : Classé Monument historique en 1991.
Km 146.4
GUÉRIGNY (2 550 hab.)
L'histoire de Guérigny est intimement liée à celle de Pierre Babaud de La Chaussade (1706-1792). Profitant des ressources naturelles environnantes, principalement le minerai de fer, les forêts de chênes et de nombreux cours d'eau, celui-ci implante et développe les forges royales. Cette manufacture, totalement liée à la construction navale, devient l'une des plus importantes de France au XVIIIe siècle. En 1781, l'État acquiert le site. Les forges poursuivent leur activité jusqu'en 1971.
Château de Villemenant
Construction : XIVe siècle.
Histoire : Villemenant est, par l’unité de son style architectural et l’harmonie de ses proportions, l’un des plus remarquables châteaux du Nivernais. On possède peu d’éléments sur sa construction. On suppose qu’il a été construit vers 1360 par Girard de Caroble, chambellan du Duc de Nevers. Vhâteau fortifié durant la guerre de cent ans, il devient château d’agrément à la Renaissance. Il est le témoin de l’essor de la sidérurgie au XVIIe et XVIIIe siècle dans le canton de Guérigby. Propriété du maître des forges, Badaud de la Chaussade, principal fournisseur des fers et des ancres de la Marine, fut rattaché au domaine royal de Louis XVI en 1781.
Destination actuelle : Ouvert à la visite, il propose également des privatisations et des chambres d’hôtes.
Classement : Classé Monument historique en 1930.
Château de la Chaussade
Construction : XVIIIe siècle.
Histoire : Construit en 1746 pour le baron Pierre Badaud de la Chaussade, créateur des forges et auteur d'un vaste projet d'urbanisme encore lisible à Guérigny. De 1880 à 1971, les chaînes et ancres de bateaux étaient la spécialité de ce site, fournisseur de la marine de guerre et des grands paquebots de la flotte commerciale. Il comprend deux ailes avec rez-de-chaussée et étage en comble. Une autre aile s'élève parallèlement à l'aile sud. Une partie du château logeait les collaborateurs du maître de forges. Les services administratifs des forges se trouvaient également dans le château.
À noter : Le site des forges est encore partiellement préservé. L'association des amis du vieux Guérigny entretient les bâtiments et propose chaque année au printemps et à l'automne une exposition sur un thème différent ayant trait à l'industrie locale ou nationale. Une exposition permanente permet de découvrir des machines à vapeur, marteaux-pilons et pièces réalisées sur le site au cours de son activité.
Classement : Inscrit Monument historique en 1930.
Km 150.3
URZY (1 730 hab.)
Château des Bordes
Construction : XIIIe siècle.
Style : Gothique, Renaissance, classique.
Histoire : La seigneurie des Bordes a appartenu aux plus illustres familles du Nivernais qui eurent très tôt des liens avec la famille royale et aussi avec la couronne de Pologne au XVIIe siècle. Le château connut son expansion maximum au XVIIe siècle, mais fut abandonné dès le XVIIIe siècle et dépecé au XXe siècle.
Caractéristiques : L'aile nord-ouest a disparu. L'aile sud-est conservant des vestiges du Moyen Age subsiste, remaniée aux XVIIe et XIXe siècles. Le grand corps de logis principal a gardé son ordonnance classique ; il est encore décoré de vestiges de peintures murales, de cheminées en pierre et d'un majestueux escalier d'honneur avec sa rampe en balustre de pierre, surmonté d'une voûte à pans coupés. Le château lui-même est complété par de nombreux éléments bâtis, formant un très grand domaine : très beau portail début XVIIe siècle et sa grille, petite maison de gardien, four à pain, communs importants et terrasses.
Destination actuelle : Privé, il se visite l’été ou le reste de l’année sur rendez-vous.
Classement : Inscrit Monument historique en 1946 et 1998.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France