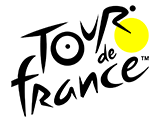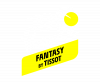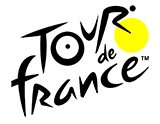PÉRIGUEUX
Site-musée Vesunna En 1959, des fouilles archéologiques ont révélé les vestiges d’une domus (villa romaine), richement ornée de peintures murales et de mosaïques. Mis en valeur par un projet scénographique et architectural de Jean-Nouvel, Vesunna protège le site archéologique classé monument historique en 1963 et présente des collections sur la ville antique et sur la vie de ses habitants entre les Ier et IIIe siècles de notre ère. Le musée bénéficie de l’appellation Musée de France depuis le 19 novembre 2009. www.perigueux-vesunna.fr
Tour de VésoneConstruction : Ier ou IIe siècle.
Histoire et caractéristiques : cette tour, haute de 24 m et d’un diamètre de 20 m, représente la partie centrale d’un des temples circulaires les plus vastes de la Gaule romaine. Elle témoigne de Vesunna, ancienne capitale romaine des Pétrocores (peuple gaulois établi dans l’actuel Dordogne). L’architecture du temple est une combinaison de deux influences culturelles : le fanum celtique, au corps circulaire (ou carré) entouré d’une galerie basse, et le modèle de temple romain avec un pronaos à colonnes ouvrant sur une cella. Cette synthèse illustre la fusion culturelle, à la fois romanisation et persistance de tradition locale.
Classement : classée Monument historique en 1846.
Amphithéâtre de PérigueuxConstruction : Ier siècle.
Histoire : la première pierre de l’amphithéâtre aurait été posée sous le règne de Tibère (14-37). Ce projet est à l’initiative de la famille Pompeia, notamment Aulus Pomp(eius) Dumnom(otus), tribun militaire et préfet des ouvriers. Entre le IIIe et IVe siècles, les remparts entourent la cité gallo-romaine, laissant en saillie l'amphithéâtre. Sa capacité est de 18 000 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus grands amphithéâtres de la Gaule aquitaine. Au Moyen Âge, le comte de Périgord implante son donjon et les tours de son fief sur les vestiges de l’amphithéâtre. À partir de 1644, les sœurs visitandines utilisent les pierres de l’amphithéâtre pour construire l’église de leur couvent. En 1688, elles découvrent une niche enfermant des statuettes de déesses romaines, qu'elles font briser à titre « d’idoles païennes ». En 1875, le conseil municipal confie la création d'un jardin-école sur le site à la Société d'horticulture. Aujourd'hui ouvert au public sous le nom de Jardin des Arènes, les vestiges ont dû être recouverts d'environ 3,50 m de remblai.
Classement : Monument historique depuis 1840.
Jardin des Arènes Ce jardin public, dont certains arbres sont séculaires, possède des plans d'eau, des aires de jeux pour les petits. Il a la particularité d’être entouré par des vestiges de l’amphithéâtre romain (Ier siècle). On aperçoit encore quelques vomitoires, cages d’escalier et voûtes.
Le Musée d’art et d’archéologie du Périgord (MAAP)Création : 1835. Caractéristiques : le musée d’art et d’archéologie du Périgord est une grande institution du XIXe. Premier musée créé en Dordogne, il propose un parcours autour de l’histoire des arts visuels de la préhistoire à nos jours. Riche de 18 500 références, la collection Préhistoire est d’ailleurs considérée comme la quatrième de France et fait l’objet de nombreuses recherches.
Label : Musée de France.
Le secteur sauvegardé Le secteur sauvegardé de Périgueux s’étend sur un peu plus de 21,5 ha. Ce quartier correspondant à la ville médiévale et Renaissance, reflète encore l’ambiance médiévale de cet ancien bourg marchand. Les maisons à pans de bois côtoient les demeures d’architecture civile romane et les hôtels particuliers Renaissance. La tour Mataguerre, dernière tour existante du rempart, est accessible en visite. Elle est classée depuis 1840. En bord de rivière, à proximité de la cathédrale, les maisons des Quais forment un ensemble architectural composé de trois demeures mitoyennes, l’hôtel Salleton inscrit en 1938, la maison des Consuls et la maison Lambert, toutes deux classées depuis 1889.
Cathédrale Saint-FrontConstruction : XIIe au XIXe siècle.
Style : roman byzantin.
Histoire : la construction d’une première église au flanc d’une colline dans l’actuelle ville de Périgueux est réputée être due à l’évêque Chronope entre 500 et 536. Au Xe siècle, l’évêque Frotaire fait construire une abbatiale. Au XIIe siècle est achevée une église à coupoles sur le modèle de la basilique Saint-Marc de Venise. Elle est agrandie jusqu’au XVIe siècle, où elle est détruite par les Huguenots. Reconstruite, elle devient cathédrale en 1669. La cathédrale subit une restauration parfois contestée au XVIIIe siècle avant d’être classée Monument historique en 1840.
Caractéristiques : elle a été construite au XIIe siècle dans un style mêlant les influences romane et byzantine. Du côté nord de la cathédrale se situe le porche de l'édifice mesurant 25 m de long, avec une terrasse comptant cinq travées. Le porche est resté intact depuis la construction de la première église. À l'est, le chevet domine le square Dabert, qui permet d'accéder aux cryptes situées sous les coupoles nord et sud. Le clocher s'élève à 62 mètres.
Classement : Monument historique en 1840 et 1889. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Compostelle en France.
Église Saint-Étienne de la CitéConstruction : XIe et XIIe siècle.
Style : roman.
Histoire : Saint-Etienne fut la première cathédrale de Périgueux, jusqu’en 1669, lorsque l’épiscopat s’installe dans la cathédrale Saint-Front. Très endommagée par les ans, l’église a été restaurée au début du XIXe siècle, puis surtout entre 2010 et 2021, alors rouverte après dix ans de travaux.
Caractéristiques : bien que largement amputée, l’ancienne cathédrale a conservé une travée d’origine de style roman et deux des quatre coupoles, dont une de quinze mètres de diamètre.
Classement : Monument historique depuis 1840.
BERGERAC
Le vignoble Le vignoble de Bergerac s'étend sur les deux rives de la Dordogne. Quelque 1 200 viticulteurs cultivent en moyenne 570.000 hl par an sur une superficie de 12 000 hectares. Cinq couleurs de vin pour 13 AOC.
Maison Peyrarède (Château Henri IV)
Construction : 1604.
Style : Renaissance.
Histoire : appelée aussi « Château Henri IV », la maison fut construite en pierres de taille en 1604 selon la volonté de Mathium Peyrarède, riche bourgeois drapier.
Destination actuelle : elle abrite le musée d’anthropologie du tabac qui accueille une formidable collection d’objets d’art du tabac, des techniques de fabrication et des objets à fumer.
Classement : inscrit Monument historique en 1947.
Château de Lespinassat
Construction : XVIe siècle.
Histoire : Le château de Lespinassat est élevé au XVIe siècle, par la famille d’Alba. Celle-ci est originaire d’Espagne et lors de son arrivée en France vers 1450, elle acquiert le domaine du château. Le bâtiment actuel est une gentilhommière qui remplace l’ancienne bâtisse défensive au XVIIe siècle, avant d’être remaniée au XVIIIe siècle, avec une campagne de travaux à partir de 1734. La galerie est bâtie à cette occasion. Le domaine possède aussi plusieurs ponts franchissant de larges fossés, des pavillons, ainsi que d’anciens chais.
Classement : inscrit Monument historique en 1989.
Vieux Pont
Construction : 1209.
Histoire : construit en 1209, après de multiples mésaventures qui privèrent la population de son accès pendant plusieurs siècles (guerre, crues, etc.), le « vieux pont » a été reconstruit en 1822 et rouvert à la circulation en 1825. Il a fêté ses deux-cents ans en 2025.
Caractéristiques : composé de cinq arches, long de 160 mètres pour une hauteur de 16 mètres, il est construit en pierres de taille et en briques.
Église Notre-Dame de Bergerac
Construction : 1856 à 1865 Style : néo-gothique.
Histoire : c’est grâce à l’abbé Julien Macerouze qu’a été édifiée cette église néo-gothique à une époque de renouveau du catholicisme sous le Second Empire. L’église est bâtie sur un point culminant de la ville dans un quartier commerçant qu’elle domine de sa tour (terminée en 1865) de 80 mètres de hauteur à trois étages. C’est l’architecte Paul Abadie qui est choisi pour ériger cette église en forme de petite cathédrale, selon les plans originels de Viollet-le-Duc, dont le devis était trop cher pour la municipalité. Elle est consacrée le 6 août 1865 par le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. Des travaux de restauration, notamment du clocher et de la flèche, ont duré dix ans de 2009 à 2019.
Caractéristiques : cette église imposante en forme de croix latine mesure 96 m de longueur, pour 22,80 m de largeur à la nef et 39,10 m au transept, avec sept contreforts de chaque côté. Son clocher surmonté d’une flèche possède trois cloches, dont la plus grosse, Marie-Immaculée, pèse plus de deux tonnes. La superficie couverte de l’église est de 2 246 m2. Le chœur s’étend sur deux travées, suivi d’un sanctuaire circulaire porté sur six piliers. Trois chapelles s’ouvrent sur le déambulatoire, ainsi que deux sacristies. Les bas-côtés sont étroits. La hauteur de la nef de 20 m donne une impression d'élégance et de légèreté.
Classement : Monument historique depuis 2002.
Église Saint-Jacques
Construction : XVIe siècle.
Style : gothique.
Histoire : une première chapelle Saint-Jacques est mentionnée en 1088. En 1345, elle est détruite par les Anglais lors de la bataille de Bergerac. Une nouvelle église est terminée en 1377. Elle est agrandie au début du XVIe siècle avec un nouveau clocher et un nouveau chœur ; mais lors des guerres de religion, la ville passe au protestantisme. L’église est saccagée et en partie détruite en 1553. La paix revenue, les religieux reviennent et le prieur rachète les ruines qu’il fait relever en 1620, en attendant la visite de Louis XIII en 1621. L’église prend son aspect actuel en 1685 grâce aux dons de Louis XIV et des consuls de la ville avec, selon un plan carré, trois nefs, sa toiture d'ardoises pour le clocher et de tuiles plates pour le reste et son clocheton. Les façades et portails datent de la fin du XVIIe siècle. Les décors et voûtes datent de 1870. Au début des années 1970, son décor intérieur est vidé d'une partie de son contenu afin de se conformer au concile Vatican II.
Classement : inscrite Monument historique en 1974.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France