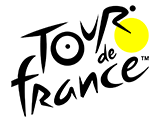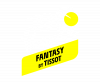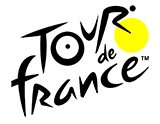NEVERS
Circuit de Nevers-Magny-Cours
Création : 1959
Histoire : créé en 1959 par Jean Bernigaud, maire de Magny-Cours, le premier circuit est une piste de karting. Le circuit Jean-Behra est inauguré en 1961. En 1986, sous l’impulsion de François Mitterrand, le conseil général de la Nièvre achète le circuit de 3 850 m à la famille Bernigaud. Réalisé en 1988, le circuit obtient son homologation en 1989, puis en 1990 un bail de cinq ans pour l’organisation du Grand Prix de France de Formule 1. Le premier Grand Prix de France de F1 a lieu le 7 juillet 1991 : Nigel Mansell s'impose devant Alain Prost.
En 1991 et 1992, le circuit accueille une manche du championnat du monde des voitures de sport. De 2000 à 2014, le Bol d'or y est organisé. En 2003, légèrement modifié, le circuit accueille la manche française du championnat du monde de Superbike. Le circuit connaît des problèmes financiers à partir de 2005 et le Grand Prix de France de F1 disparaît de 2009 à 2018, où il est à nouveau organisé, mais au Circuit Paul Ricard. Depuis la disparition du Grand Prix de France à Magny-Cours, le circuit a entrepris de nombreux changements. Le prolongement, en octobre 2010, de l'autoroute A77 permet désormais un accès direct au circuit, qui redevient bénéficiaire en 2011. En 2014, d'importants travaux de modernisation du bâtiment principal sont engagés (boxes, loges et espaces VIP).
Caractéristiques : Aujourd'hui long de 4 411 m, le circuit de Magny-Cours reprend des virages existant sur d’autres circuits de Formule 1, ce qui en fait une piste très technique et très complète. La piste présente un dénivelé d'une trentaine de mètres avec une zone en descente suivant la ligne de départ dans la grande courbe jusqu’à la cuvette d’Estoril, suivie d'une longue remontée jusqu’à l'épingle d’Adelaide, un plateau jusqu’à Château d’eau qui est suivi d’une descente jusqu’à la zone du Lycée qui ramène au départ. La piste accueille tout au long de l'année différentes manifestations sportives, des essais de grandes équipes françaises ou étrangères, des clubs de prestige ou encore des stages de pilotage.
Le circuit et le cyclisme : le circuit de Magny-Cours a accueilli Paris-Nice à deux reprises, en 2014 pour une arrivée au sprint enlevée par John Degenkolb, et pour le départ de la troisième étape de l’édition 2025, un contre-la-montre par équipes dominé par l’équipe Visma-Lease a bike.
Palais ducalConstruction : XVe et XVIe siècle. Style : Renaissance. Histoire : considéré comme le premier des châteaux de la Loire, construit sur la butte qui domine le centre de la vieille ville, le Palais ducal domine de sa large façade renaissance encadrée de tourelles polygonales, la place de la République. Il fut la résidence des comtes puis des ducs du Nivernais. Il fut construit pour Jean de Clamecy, comte de Nevers, à la place de son ancienne forteresse. Les deux grosses tours sont les plus anciennes, car le château fut remanié au XVIe siècle par la famille de Clèves. Madame de Cossé-Brissac, héritière du dernier duc de Nevers, vend le château et ses dépendances à la ville et au département en 1810. L’édifice est alors partagé entre la mairie et le tribunal de justice jusqu'en 1850. À la fin des années 1970, la Ville, soucieuse de récupérer un des plus beaux monuments historiques de Nevers, propose le transfert du palais de justice dans l’ancien palais épiscopal. Une nouvelle restauration est lancée, conservant la distribution du XIXe siècle mais ajoutant un escalier monumental et une nouvelle entrée latérale.
Destination actuelle : restauré sur ordre de Pierre Bérégovoy dans les années 1980, le palais abrite aujourd'hui l’hôtel de ville (dont le bureau du maire et la salle des conseils), une partie de l’office de tourisme, des salles d’expositions et de réception, ainsi qu’une exposition permanente sur l’histoire et les atouts de la ville (Formule 1, faïence, etc.) ainsi qu’un aquarium de poissons ligériens.
À noter : le 4 mai 1993, c’est devant le Palais ducal que le président François Mitterrand, prononce l’éloge funèbre de Pierre Bérégovoy, qui s’était suicidé le 1er mai, discours resté célèbre pour une phrase : « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu’on ait pu livrer aux chiens l'honneur d’un homme. » Classement : classé Monument historique en 1840.
Faïence de Nevers Nevers doit à Louis IV de Nevers sa célèbre activité de faïencerie. Vers la fin du XVIe siècle, il fit venir d’ItalieAugustin Conrad, potier d’Albissola, près de Savone, et ses frères, Baptiste et Dominique qu’il installa au château du Marais à Gimouille. Leur réputation et leur réussite devinrent telles que Nevers s’affirma au XVIIe siècle comme la capitale française de la faïence. Augustin Conrad avait choisi Nevers pour s’implanter en France car tous les éléments étaient réunis pour fabriquer de la faïence de qualité : les deux types de terre nécessaires, du bois qui chauffe mais ne fait pas de feu (dans les forêts du Morvan), et la Loire pour le transport sécurisé de ses produits. Au XXIe siècle, quelques faïenceries perpétuent et renouvellent cette activité.
La spécificité de la faïence de Nevers est le fameux « Bleu de Nevers », une couleur obtenue par un bain d'émail au bleu de cobalt. Beaucoup de faïenciers signent également leurs créations en dessinant un petit « nœud vert ».
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Création : 1840
Histoire : créé à l’hôtel de ville, le musée a déménagé dans les années 1910 dans l’ancien palais épiscopal, acquis et offert à la ville par un mécène, Frédéric Blandin. En 1975, il s’installe à l’emplacement de l’ancienne abbaye bénédictine Notre-Dame et dans un hôtel particulier, la maison Roussignhol, datant du XIXe siècle. Ces locaux ont été rénovés de 2007 à 2013 et complétés par une extension contemporaine. Les travaux terminés, le musée a été inauguré le 27 septembre 2013.
Caractéristiques : le musée compte depuis 13 salles d’exposition permanente et une salle d’exposition temporaire qui s’étendent sur 2 100 m2 de vestiges médiévaux, de réhabilitations et de constructions neuves. Un choix architectural associe pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes.
Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
Construction : Xe au XVIe siècle. Style : roman et gothique.
Histoire :Cyr et Julitte furent suppliciés vers l’an 304, au cours des persécutions ordonnées par l’empereur romain Dioclétien. Jérôme, évêque de Nevers de 800 à 816, ramène des reliques des deux saints à Nevers au IXe siècle. Au début du XIIIe siècle, la cathédrale se compose d’une nef charpentée, d’un transept et d’un chœur. Deux tours flanquent les façades orientales au nord et au sud. Après un incendie en 1211, l’évêque Guillaume de Saint-Lazare la reconstruisit dans le style « nouveau » gothique. La cathédrale présente alors une élévation à trois étages. Le chœur et le transept roman, moins atteints par l’incendie, sont conservés. La reconstruction après un nouvel incendie en 1308 a été rapide puisqu'en 1331, Pierre La Palud, patriarche latin de Jérusalem, consacra l’édifice, désormais de style gothique rayonnant. De nombreuses restaurations suivront jusqu’à nos jours (notamment après la Seconde Guerre mondiale où la cathédrale est touchée par erreur et où tous les vitraux ont dû être reconstruits). Les 18 chapelles latérales sont restaurées depuis 2021.
Caractéristiques : la longueur totale de l'édifice fait 101 m. Le chœur roman (XIe siècle) dit de sainte Julitte est voûté en cul-de-four. Il abrite une fresque exceptionnelle représentant le Christ en gloire, entouré des symboles des évangélistes et des vieillards de l'Apocalypse.
La petite histoire : l’évêque de Nevers, Jérôme, aurait rapporté les reliques de saint Cyr à Nevers à la suite d’un rêve de Charlemagne, dans lequel le saint aurait sauvé l’empereur de la charge d’un sanglier furieux.
Signes particuliers : les vitraux détruits en 1944 ont été reconstruits au cours du XXe siècle par des artistes contemporains aussi connus que Claude Viallat, Jean-Michel Alberola, Raoul Ubac, François Rouan ou Gottfried Honegger. Classement :Monument historique depuis 1862.
Espace Bernadette-Soubirous C’est un site de pèlerinage autour de sainte Bernadette, célèbre pour ses visions de la Sainte Vierge à Lourdes, et qui est décédée à Nevers en 1879. Elle a passé les dernières années de sa vie au couvent des Sœurs de la charité de Nevers, installé dans un ancien prieuré du XIIe siècle. Il s’agit aujourd’hui à la fois d'un centre spirituel, d’un lieu de retraite mais également d’échanges et de rencontres. Bernadette repose dans la chapelle Saint-Joseph, située au cœur des jardins de l’espace.
Église Saint-Étienne de Nevers
Construction : XIe siècle. Style : roman.
Histoire : l’église Saint-Étienne de Nevers est l’une des églises de style roman les plus belles et les mieux conservées de France. L’édifice est consacré en 1097 par l’évêque Yves de Chartres. Son architecture s’inscrit pleinement dans le mouvement de la fin du XIe siècle et rappelle d’autres chefs d’œuvre de l’art roman comme Saint-Sernin de Toulouse ; le chœur est bâti dans l’esprit de la grande abbatiale de Cluny ; enfin l’élévation est à trois niveaux comme à Jumièges ou à la basilique Saint-Rémi de Reims. L’église eut à souffrir des modes, des conflits et des vicissitudes du temps. Désaffectée à la Rvolution, elle est transformée en grange : ses trois clochers romans et le narthex sont détruits en 1792.
En 1846, consciente que Nevers possédait un monument roman exceptionnel, la mairie lança des travaux importants. Malgré ces restaurations, c’est l’un des rares monuments du XIe siècle qui nous soit parvenu sans altération majeure de sa pureté primitive.
Caractéristiques : vu de l’extérieur, l’édifice offre un aspect massif, imposant, sorte de forteresse religieuse, construit en pierres de taille soigneusement équarries avec ses baies aux contours nus et muets. L’église Saint-Étienne fournit une illustration exemplaire des deux phénomènes : d’une part l’interaction entre différentes régions de la France romane et d'autre part l’importance de la Bourgogne en tant que plaque tournante et « inventeur » de solutions architecturales et plastiques.
Classement :Monument historique depuis 1840
CHALON-SUR-SAÔNE
Cathédrale Saint-Vincent et cloître des Chanoines
Construction : XIe au XVe siècle.
Style : roman et gothique.
Histoire : la construction de la cathédrale Saint-Vincent s’est étalée sur six siècles. L’édifice mêle le roman et le gothique. Tout commence en 1090. De cette époque, il reste les chapelles absidiales nord et sud. Suivirent au XIIe siècle : le chœur, le transept et les piliers et arcades de la nef et des bas-côtés. Au style roman succède le gothique des XIIIe et XIVe siècles avec l'abside du chœur, les murs de la nef et du cloître, la voûte de la croisée du transept. Enfin, au XVe siècle, la voûte de la nef et les chapelles des bas-côtés sont achevées. En 1562, la fureur huguenote dévaste l'église : les statues sont détruites, le trésor enlevé. Au cours des deux siècles suivants, le changement de goût architectural fait disparaître certains éléments gothiques (tombeaux, stalles et jubé). À la Rvolution, l’évêché est supprimé, l’église est dédiée à la déesse Raison et sert d’entrepôt à fourrage. Les XIXe et XXe siècles se consacrent aux réparations. Une façade néogothique est achevée vers 1850, la toiture est refaite vers la fin du XIXe et ses tours restaurées en 1991.
Classement :Monument historique depuis 1903.
Ancien hôpital
Construction : 1530 (fondation) à 1854 (façade).
Histoire : L’hôpital de Chalon a été créé au XVIe siècle (bâtiment sur galeries d’arcades, réaménagé au XVIIIe siècle). Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, modernisation, humanisation, démolitions et constructions métamorphosèrent l’établissement devenu Centre Hospitalier William-Morey. Entreprise en 2008, la construction du « Nouvel Hôpital du Chalonnais », au nord de la ville, a entraîné, en 2011, la désaffectation de l’édifice, qui fait depuis l’objet de différents projets de rénovation.
Caractéristiques : le plan de cet hôpital, établi sur l’île Saint-Laurent, a considérablement évolué au cours des siècles. Sa partie la plus ancienne se compose de plusieurs corps de bâtiment, d’époques différentes, répartis autour de trois cours et dominés par une tour-lanterne coiffée d’un dôme. Le long du quai de la Saône s’alignent le vaste corps de bâtiment édifié en 1854 et le corps de logis des religieuses, datant du XVIe siècle, qui se signale par son pignon à redents.
Classement : inscrit Monument historique en 1932.
Tour du Doyenné
Construction : XVIe siècle. Histoire : elle servait au Moyen Âge d’escalier pour desservir les étages de la maison du doyen des chanoines. En 1907, elle est vendue, démontée et transportée à Paris. Après la Première Guerre mondiale, un mécène la retrouve et l’offre à la ville qui l’a réinstallée.
Classement : inscrite Monument historique en 1948.
Nicéphore Niépce Issu d’une famille aisée de la bourgeoisie bourguignonne (son père est avocat et conseiller du roi), Joseph Niépce envisage un temps de devenir prêtre avant d’y renoncer en 1788. Quand éclate la Révolution, il rejoint la Garde nationale et adopte le surnom de Nicéphore. Mais dès 1794, sa vue déficiente le contraint à abandonner la carrière militaire. Il s'établit alors à Nice. En 1801, tous regagnent la propriété des Niépce, à Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône, pour assurer la gestion du patrimoine familial.
Férus de physique et de chimie, Claude et Nicéphore mettent au point ensemble un moteur d'un genre nouveau, le Pyréolophore, ancêtre du diesel, pour lequel ils obtiennent un brevet valable dix ans. En l'absence de son frère, Nicéphore entreprend seul, en 1816, de nouvelles recherches sur un sujet qui lui tient depuis longtemps à cœur : la fixation des images. Il parvient, en mai 1816, grâce à une chambre noire, chargée avec un papier enduit de chlorure d'argent, à obtenir un négatif d’une vue prise depuis une fenêtre. En 1822, il commence à expérimenter le bitume de Judée : une plaque de cuivre enduite de cette substance et exposée huit heures durant dans la chambre noire, puis plongée dans un solvant et attaquée par un acide dans les parties dépourvues de bitume fournit ainsi une image en relief. Nicéphore obtient en 1827, par ce procédé qu'il appelle Héliographie, après huit heures d'exposition, ce qui constitue la toute première photographie : une vue prise d’une fenêtre du grenier de sa maison de Saint-Loup-de-Varennes.
On lui doit aussi :
la première chambre noire photographique, la première chambre coulissante, le premier diaphragme à iris (réinventé cinquante ans plus tard), une chambre munie d’une bobine pour l’enroulement du papier sensible.Après avoir rencontré Louis Jacques Mandé Daguerre, un peintre décorateur qui utilise la chambre noire pour faire les croquis de ses dioramas, Niépce s'associe avec lui en 1829 pour parfaire ses réalisations « héliographiques ». Mais il meurt subitement quatre ans plus tard, d'une hémorragie cérébrale, lourdement endetté et sans être parvenu à intéresser personne à son invention. C'est Daguerre qui, reprenant à son compte les expériences de son associé, réussira à développer (1835), puis à fixer (daguerréotype, 1838) les images photographiques, et en retirera de son vivant une grande célébrité. Le rôle de Nicéphore Niépce dans l’invention de la photographie est cependant pleinement reconnu aujourd’hui.
Statue de bronze Nicéphore Niépce Installée place du Port-Villiers, elle fut réalisée en 1885 par Eugène Guillaume, un sculpteur qui travailla gratuitement afin d’honorer son modèle.
Musée Nicéphore Niépce Le musée est installé dans un ancien hôtel des messageries royales (fin XVIIIe siècle). Il s’agit d’un bâtiment en front de Saône organisé en U, remarquable par sa poutraison massive. Constituées à partir des appareillages divers, des plaques héliographiques et des objets personnels de Nicéphore Niépce, les collections se sont étoffées par les dons et acquisitions successifs d’appareils photographiques et autres objets d’une part, et les photographies et autres images d’autre part.
Hôtel de ville Typique des petits hôtels particuliers avec sculptures sur les façades qui, après avoir appartenu à de riches marchands, sont transformés en habitat. L’Hôtel de ville est installé dans l’ancien hôtel particulier d’un industriel chalonnais (fin XIXe, début XXe) avec un intérieur étonnant dont des plafonds à caissons, des moulures…
Chalon dans la rueFestival annuel de spectacle de rue créé en 1987 qui accueille plus de 200 000 spectateurs en 5 jours, fin juillet, ce qui en fait l’un des plus importants festivals d’arts de la rue organisé en France. Référence incontournable de la création en espace public, le festival Chalon dans la rue reflète l’actualité des arts de la rue. Chaque année, ce sont près de 180 compagnies françaises et internationales qui s’emparent de Chalon-sur-Saône. Les compagnies historiques se mêlent aux plus jeunes, les arts de la rue aux arts numériques, le spectacle vivant aux performances.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France