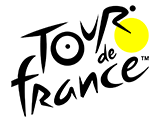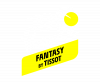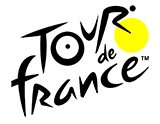- Ville-étape pour la 24e fois
- Commune de l’Isère (38)
- Habitants 2 900 (Bourcats et Bourcates)
Le peloton passe généralement au Bourg d’Oisans avant de s’attaquer à la montée de l’Alpe d’Huez. La commune iséroise a aussi donné lieu à de nombreux départs d’étapes de montagne historiques, comme la première fois en 1952 lorsque Fausto Coppi a enchaîné ses succès à l’Alpe et à Sestrières. Mais c’est bien en direction de Saint-Étienne que l’on quitte le plus souvent Le Bourg d’Oisans. L’intitulé de l’étape a été proposé cinq fois aux coureurs : Franco Chioccoli en 1992, Maximilian Sciandri en 1995, Ludo Dierckxsens en 1999, Marcus Burghardt en 2008 et Mads Pedersen en 2022, y ont associé leurs noms.
mairie-bourgdoisans.fr
ccoisans.fr
isere.fr
LE BOURG D’OISANS
Station de l’Alpe d’Huez
Origine : Développement à partir des années 1920
Histoire et caractéristiques : Premier téléski à perches inauguré en 1936 par Jean Pomagalski, fondateur de Poma. La station fait partie du domaine skiable Alpe d’Huez Grand Domaine Ski : 250 km de pistes sur 10 000 hectares, dont 840 skiables, avec un dénivelé de 2 223 m et 70 remontées mécaniques. 135 pistes balisées (42 vertes, 37 bleues, 39 rouges, 17 noires), dont la piste noire Sarenne longue de 8 km. La station a formé des skieurs célèbres comme Fabienne Serrat, Laure Péquegnot, Alizée Baron ou Valentin Giraud-Moine.
Musée Galta
Caractéristiques : Musée des minéraux et de la faune des Alpes, installé dans les combles de l’église Saint-Laurent. Centre d’accueil du Parc national des Écrins, il propose une scénographie sensorielle et interactive, rénovée entre 2023 et 2025.
Voie romaine de Rochetaillée
Histoire et caractéristiques : Voie taillée dans la falaise, reliant la Gaule à l’Italie le long du Lac Saint-Laurent (comblé en 1219). Répertoriée dans la Table de Peutinger, son origine reste incertaine : romaine ou plus ancienne.
Orgue « Colette-Anne »
Installation : Église Saint-Laurent, 2015
Caractéristiques : Orgue de la Résurrection réalisé par le facteur Giroud selon les plans de l’architecte Martin Bacot. En forme de puits de lumière, il rend hommage à l’organiste Colette Oudet.
Site officiel
Les lacs
Caractéristiques : Lacs naturels de Lauvitel (partiellement réserve intégrale), Petites Sources-Lac bleu et Buclet. Connus pour leurs eaux turquoise ou glacées, ils constituent un cadre naturel exceptionnel pour la randonnée et les activités en plein air.
Parc national des Écrins
Gaspard le cristallier
Caractéristiques : Géant traditionnel porté, baptisé en 2018 en hommage à Gaspard de la Meije et au métier de cristallier. Unique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est une attraction locale et un vecteur promotionnel du territoire.
Usine des Vernes
Fondation : 1918
Histoire et caractéristiques : Centrale hydroélectrique exemplaire construite en deux ans pour contribuer à l’effort de guerre. Modèle d’architecture industrielle et touristique conciliant production d’énergie et préservation du patrimoine.
Classement : Monument Historique depuis 1994
Site officiel
Parc national des Écrins
Caractéristiques : Cœur protégé de 91 800 ha, abritant une biodiversité riche avec espèces rares et menacées. Découverte possible via la Maison du Parc du Bourg d’Oisans ou accompagnée par des guides de haute montagne. Plus de 100 itinéraires de randonnée détaillés sur le site officiel.
Site officiel