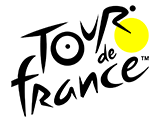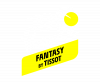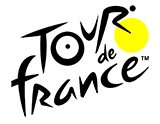- Ville-étape : pour la 5e fois
- Préfecture : de la Dordogne (24)
- Habitants : 29 900 (Périgourdins et Périgourdines)
Sur le Tour, le nom de la préfecture de la Dordogne est lié à ceux de rouleurs hors du commun s’étant illustrés sur des chronos partant ou arrivant à Périgueux. Jacques Anquetil y a livré une réelle démonstration en 1961, en rajoutant ce jour-là près de trois minutes à son avance sur Charly Gaul. En 1994, c’est sur cette étape, dessinée en sens inverse à destination de Bergerac, que Miguel Indurain enfilait le Maillot Jaune. Vingt ans plus tard, la tradition était respectée avec un succès de Tony Martin.
perigueux.fr
dordogne.fr
PÉRIGUEUX
Site-musée Vesunna En 1959, des fouilles archéologiques ont révélé les vestiges d’une domus (villa romaine), richement ornée de peintures murales et de mosaïques. Mis en valeur par un projet scénographique et architectural de Jean-Nouvel, Vesunna protège le site archéologique classé monument historique en 1963 et présente des collections sur la ville antique et sur la vie de ses habitants entre les Ier et IIIe siècles de notre ère. Le musée bénéficie de l’appellation Musée de France depuis le 19 novembre 2009. www.perigueux-vesunna.fr
Tour de Vésone Construction : Ier ou IIe siècle. Histoire et caractéristiques : cette tour, haute de 24 m et d’un diamètre de 20 m, représente la partie centrale d’un des temples circulaires les plus vastes de la Gaule romaine. Elle témoigne de Vesunna, ancienne capitale romaine des Pétrocores (peuple gaulois établi dans l’actuel Dordogne). L’architecture du temple est une combinaison de deux influences culturelles : le fanum celtique, au corps circulaire (ou carré) entouré d’une galerie basse, et le modèle de temple romain avec un pronaos à colonnes ouvrant sur une cella. Cette synthèse illustre la fusion culturelle, à la fois romanisation et persistance de tradition locale. Classement : classée Monument historique en 1846.
Amphithéâtre de Périgueux Construction : Ier siècle. Histoire : la première pierre de l’amphithéâtre aurait été posée sous le règne de Tibère (14-37). Ce projet est à l’initiative de la famille Pompeia, notamment Aulus Pomp(eius) Dumnom(otus), tribun militaire et préfet des ouvriers. Entre le IIIe et IVe siècles, les remparts entourent la cité gallo-romaine, laissant en saillie l'amphithéâtre. Sa capacité est de 18 000 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus grands amphithéâtres de la Gaule aquitaine. Au Moyen Âge, le comte de Périgord implante son donjon et les tours de son fief sur les vestiges de l’amphithéâtre. À partir de 1644, les sœurs visitandines utilisent les pierres de l’amphithéâtre pour construire l’église de leur couvent. En 1688, elles découvrent une niche enfermant des statuettes de déesses romaines, qu'elles font briser à titre « d’idoles païennes ». En 1875, le conseil municipal confie la création d'un jardin-école sur le site à la Société d'horticulture. Aujourd'hui ouvert au public sous le nom de Jardin des Arènes, les vestiges ont dû être recouverts d'environ 3,50 m de remblai. Classement : Monument historique depuis 1840.
Jardin des Arènes Ce jardin public, dont certains arbres sont séculaires, possède des plans d'eau, des aires de jeux pour les petits. Il a la particularité d’être entouré par des vestiges de l’amphithéâtre romain (Ier siècle). On aperçoit encore quelques vomitoires, cages d’escalier et voûtes.
Le Musée d’art et d’archéologie du Périgord (MAAP) Création : 1835. Caractéristiques : le musée d’art et d’archéologie du Périgord est une grande institution du XIXe. Premier musée créé en Dordogne, il propose un parcours autour de l’histoire des arts visuels de la préhistoire à nos jours. Riche de 18 500 références, la collection Préhistoire est d’ailleurs considérée comme la quatrième de France et fait l’objet de nombreuses recherches. Label : Musée de France.
Le secteur sauvegardé Le secteur sauvegardé de Périgueux s’étend sur un peu plus de 21,5 ha. Ce quartier correspondant à la ville médiévale et Renaissance, reflète encore l’ambiance médiévale de cet ancien bourg marchand. Les maisons à pans de bois côtoient les demeures d’architecture civile romane et les hôtels particuliers Renaissance. La tour Mataguerre, dernière tour existante du rempart, est accessible en visite. Elle est classée depuis 1840. En bord de rivière, à proximité de la cathédrale, les maisons des Quais forment un ensemble architectural composé de trois demeures mitoyennes, l’hôtel Salleton inscrit en 1938, la maison des Consuls et la maison Lambert, toutes deux classées depuis 1889.
Cathédrale Saint-Front Construction : XIIe au XIXe siècle. Style : roman byzantin. Histoire : la construction d’une première église au flanc d’une colline dans l’actuelle ville de Périgueux est réputée être due à l’évêque Chronope entre 500 et 536. Au Xe siècle, l’évêque Frotaire fait construire une abbatiale. Au XIIe siècle est achevée une église à coupoles sur le modèle de la basilique Saint-Marc de Venise. Elle est agrandie jusqu’au XVIe siècle, où elle est détruite par les Huguenots. Reconstruite, elle devient cathédrale en 1669. La cathédrale subit une restauration parfois contestée au XVIIIe siècle avant d’être classée Monument historique en 1840. Caractéristiques : elle a été construite au XIIe siècle dans un style mêlant les influences romane et byzantine. Du côté nord de la cathédrale se situe le porche de l'édifice mesurant 25 m de long, avec une terrasse comptant cinq travées. Le porche est resté intact depuis la construction de la première église. À l'est, le chevet domine le square Dabert, qui permet d'accéder aux cryptes situées sous les coupoles nord et sud. Le clocher s'élève à 62 mètres. Classement : Monument historique en 1840 et 1889. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Compostelle en France.
Église Saint-Étienne de la Cité Construction : XIe et XIIe siècle. Style : roman. Histoire : Saint-Etienne fut la première cathédrale de Périgueux, jusqu’en 1669, lorsque l’épiscopat s’installe dans la cathédrale Saint-Front. Très endommagée par les ans, l’église a été restaurée au début du XIXe siècle, puis surtout entre 2010 et 2021, alors rouverte après dix ans de travaux. Caractéristiques : bien que largement amputée, l’ancienne cathédrale a conservé une travée d’origine de style roman et deux des quatre coupoles, dont une de quinze mètres de diamètre. Classement : Monument historique depuis 1840.